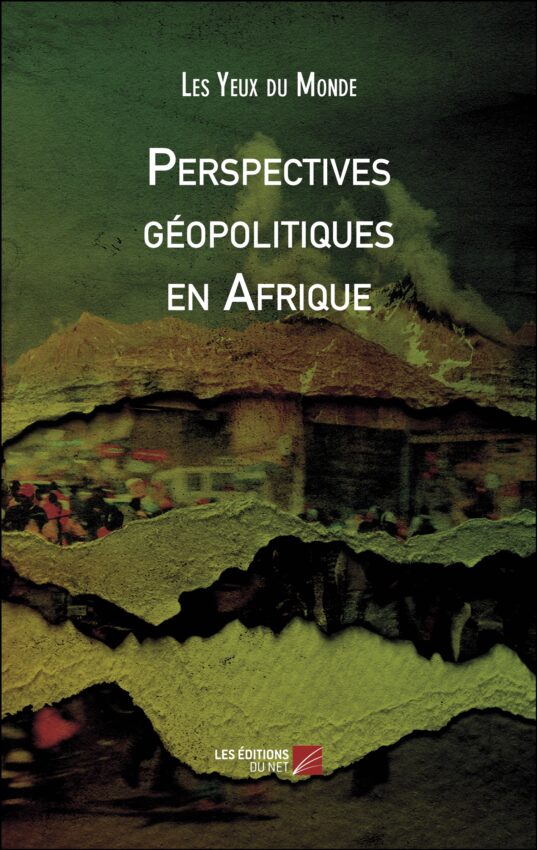Quel bilan international pour le troisième mandat de Vladimir Poutine ? Entretien avec Isabelle Facon
 Isabelle Facon est maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS). Elle est spécialiste des politiques de sécurité et de défense russes. Elle s’intéresse notamment à la transformation de l’outil militaire russe et aux évolutions dans l’industrie d’armement. Elle a par ailleurs consacré de nombreux travaux à la politique étrangère de la Russie, en particulier son positionnement en Europe et ses relations asiatiques.
Isabelle Facon est maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS). Elle est spécialiste des politiques de sécurité et de défense russes. Elle s’intéresse notamment à la transformation de l’outil militaire russe et aux évolutions dans l’industrie d’armement. Elle a par ailleurs consacré de nombreux travaux à la politique étrangère de la Russie, en particulier son positionnement en Europe et ses relations asiatiques.
Fabien Herbert : Quelle a été la stratégie internationale de V. Poutine entre 2012 et 2018 ? Y a t-il eu plusieurs phases ?
Isabelle Facon : Initialement le projet clef de politique étrangère de V. Poutine pour son troisième mandat était l’intégration eurasiatique (avec les pays de l’ex-URSS), via l’Union économique eurasiatique (UEE). Celle-ci a bien été lancée en 2015 mais le conflit avec l’Ukraine rend impensable la participation de cette dernière à l’UEE, ce qui était une ambition centrale du Kremlin. En outre, depuis ce conflit, les pays membres les plus proches de la Russie – Belarus, Kazakhstan – se méfient de la dimension géopolitique que Moscou voudrait imprimer au projet, et cette méfiance contribue à ralentir les processus d’intégration, également compliqués par la crise économique russe de 2014-2016.
En réalité, la Russie a surtout « couru » derrière des événements au cours du troisième mandat de Poutine – plutôt qu’elle ne les a dessinés aux termes d’une stratégie très articulée. La crise ukrainienne a révélé la profondeur des tensions russo-occidentales accumulées (avant elle, les politologues russes et occidentaux se demandaient depuis plusieurs années si la Russie n’allait pas « quitter l’Occident »), les précipitant dans une spirale d’antagonisme dont il va être difficile de sortir. Par ailleurs, l’intervention en Syrie l’a contrainte à travailler beaucoup plus étroitement et finement sa diplomatie moyen-orientale – non sans certains succès.
Enfin, la crise de ses relations avec les Occidentaux l’a amenée à accélérer son mouvement de rééquilibrage de sa politique étrangère et de ses relations économiques extérieures vers l’Asie, souhaité par Poutine depuis le milieu des années 2000 et devenu plus tangible depuis le début de la décennie 2010. Dans ce cadre on voit que la Russie, tout en en craignant les implications géopolitiques potentielles (notamment en Asie centrale), cherche à « récupérer » la dynamique des nouvelles routes de la soie chinoises pour montrer qu’elle n’est pas isolée et pour relancer l’intégration eurasiatique.
F.H : Les interventions en Crimée (2014) et en Syrie (2015) sont temporellement rapprochées, peut-on y voir un rapport et si oui dans quelle mesure ?
I.F : Chacune des interventions a bien sûr sa logique et ses déterminants propres. La Russie est intervenue en Crimée parce qu’elle a considéré, ce qui n’est pas étonnant si l’on tient compte de certains traits fondamentaux de sa culture stratégique, que les événements à Kiev risquaient d’accélérer l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et de la priver de son accès à Sébastopol, au profit de l’Alliance atlantique – un cauchemar stratégique du point de vue russe. Moscou a décidé d’intervenir en Syrie parce que le régime Assad était alors en grandes difficultés militairement – un régime que la Russie, par principe, veut protéger contre ce qu’elle voit comme le risque d’un nouveau changement de régime voulu par les Occidentaux, considérant que des intérêts cruciaux pour elle sont associés au régime ; à prendre en compte également, la certitude qu’une alternance au pouvoir en Syrie sous « pilotage occidental » serait source d’un surplus de chaos susceptible d’impacter son flanc sud (Caucase, Asie centrale).
Il y a cependant des points de recoupement dans les motivations du pouvoir russe quand il décide d’intervenir dans les deux cas. En Ukraine comme en Syrie, les tensions et les incompréhensions avec le monde occidental sont des éléments de motivation très forts. Clairement, la Russie est d’autant plus intéressée à l’intervention en Syrie en 2015 qu’elle a probablement envie de damer le pion aux Occidentaux dans le contexte des sanctions. Ensuite, il s’agit de montrer que l’armée russe est de retour, capable de soutenir la diplomatie russe et de protéger les intérêts du pays. Le message est : désormais, la Russie a les moyens de faire respecter ses « lignes rouges ». Et, en Syrie, de faire mentir le président Obama, qui avait déclaré en 2014 (en substance) que la Russie n’était qu’une puissance régionale (qui de surcroît ne savait assurer son influence que par la coercition).
F.H : Quelles conséquences ont eu ces deux guerres sur l’opinion mondiale et russe ?
I.F : Globalement, l’idée de la « résurgence » de la Russie – comme grande puissance, comme menace, c’est selon – s’impose. Dans les opinions publiques, si l’on en croit les enquêtes du Pew Research Center, l’image de la Russie souffre de sa démonstration de force permanente. Toutes régions confondues, la proportion de personnes considérant que le président Poutine « fait ce qu’il faut dans les affaires internationales » n’est pas élevée – de 19% (Europe) à 35% (Afrique). La part d’opinions favorables sur la Russie ne dépasse pas 37% (en Asie Pacifique, moins ailleurs).
Au niveau des élites politiques, l’image de la Russie est évidemment plus dégradée en Europe et aux États-Unis qu’en Afrique ou en Asie. En Asie et au Moyen-Orient, il apparaît que, alors que l’engagement des États-Unis pose des questions (et ce dès avant l’élection de Trump), le regain de vitalité militaire et diplomatique russe amène certains gouvernements à s’interroger – prudemment pour l’instant – sur le potentiel de la Russie comme force d’équilibre. La perception de la puissance et de l’influence de la Russie « comme menace pour notre pays » est plus forte aux États-Unis (47%) et en Europe (41%) qu’ailleurs (Afrique : 31%, Asie Pacifique : 29%, Moyen-Orient : 35%, Amérique latine : 23%).
En Russie, indéniablement, la population partage avec le pouvoir, qui met considérablement en scène le regain de respectabilité internationale du pays (discours officiel, médias), la satisfaction quant à la meilleure image que le pays a acquise ces dernières années – meilleure dans le sens d’image de pays fort, qui défend fermement son intérêt. Car comme l’avait dit Pierre Hassner au moment de la guerre en Géorgie, « la Russie préfère être crainte qu’être aimée ».
F.H : Arrivons nous, aujourd‘hui, vers une période de « détente » entre la Russie et les États occidentaux ? (Macron, Trump?)
I.F : Avec Trump, il était illusoire d’emblée d’attendre de son élection un rapprochement significatif et rapide, a fortiori un « grand bargain », « un nouveau Yalta » dont les Européens auraient été les victimes, ce que prédisaient beaucoup d’experts occidentaux. Moscou ne voit pas encore de signes très probants du désengagement attendu de la puissance américaine en Eurasie et en Europe mais l’espère probablement encore. Pour le reste, et l’Adresse du président à l’Assemblée fédérale du 1er mars l’a montré avec une clarté particulière, la Russie semble résignée, pour les années à venir, au maintien d’une relation très tendue et transactionnelle avec Washington – les adversaires politiques de Trump ayant fait du « dossier russe » leur arme principale pour le contrer. La principale question est de savoir si Moscou cherchera à faire du damage limitation ou poussera la logique de confrontation plus loin.
Avec Macron, le ton a changé, c’est certain – le président français ayant reçu Poutine à Versailles, et ayant même déclaré, en substance, qu’il ne pensait pas que la Russie voulait affaiblir l’Europe. Il est certain que la Russie s’interroge sur le potentiel que peut amener cette évolution à Paris par rapport à sa relation avec l’Europe, et sur la question de savoir si le président français pourra jouer la carte de l’ouverture plus aisément à l’heure où Angela Merkel, très remontée contre Moscou depuis l’annexion de la Crimée, est actuellement plus mobilisée sur les questions intérieures. Cela étant dit, le renforcement de l’Union européenne est la priorité du président français, ce qui peut réduire ses marges de manœuvre dans une éventuelle démarche de rapprochement avec Moscou.
Ce que la Russie espère sans doute, en mettant lourdement l’accent sur les risques dont est porteuse la remilitarisation des rapports stratégiques Occident-Russie, c’est que les Européens, compte tenu de la situation aux États-Unis et des tensions entre eux et l’Europe (guerres commerciales, avenir de l’accord sur le nucléaire iranien, engagement sur le réchauffement climatique, etc.), s’auto-saisissent du dossier « interruption de la spirale des hostilités avec Moscou ». Quoi qu’il arrive, les progrès seront lents – on part de très loin.
F.H : Le bilan est-il positif ou négatif pour la Russie ? (ou mitigé…)
I.F : Vu des pays occidentaux, le bilan est négatif pour la Russie : sanctions, isolement, au détriment de la santé économique et de la sécurité du pays, mauvaise réputation internationale, aggravation du déséquilibre du rapport de force avec la Chine, etc. En Russie, comme suggéré précédemment, la visibilité retrouvée du pays sur la scène internationale compense les effets négatifs – les sanctions (« psychologie » nationale et propagande du pouvoir aidant) sont perçues non pas comme une punition infligée au pays du fait de la mauvaise politique du président, mais comme un symptôme de la volonté des pays occidentaux d’affaiblir la Russie, aujourd’hui comme hier.
La vérité est sans doute entre les deux lectures. La Russie n’est pas isolée en dehors du monde occidental, même si quelques pays ont suivi les sanctions et si d’autres profitent de cette crise russo-occidentale pour pousser leurs avantages (Chine). Moscou peut diversifier ses partenariats. Mais elle doit démontrer à ses partenaires non occidentaux qu’elle est capable de jouer un rôle politique et stratégique constructif, et il n’est pas certain que les nouveaux partenariats compensent pleinement les manques créés par les sanctions occidentales (accès aux marchés financiers, transferts de technologies, investissements…).