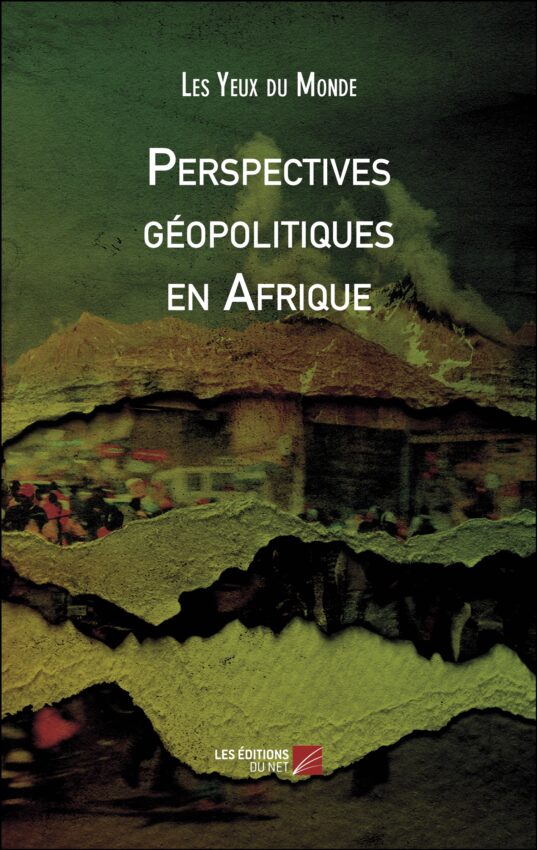Chili : chaos et échec de l’ultralibéralisme (2/2)
Le Chili, symbole de stabilité, de prospérité et d’ultralibéralisme réussi, est le dernier pays latino-américain en date à avoir sombré dans le chaos. La hausse du prix du ticket de métro a déclenché une grave crise sociale. Quatre semaines après le début de la contestation, le gouvernement de Sebastián Piñera est dans l’impasse. Aucune des mesures proposées ne semble à même de satisfaire les manifestants, qui demandent un changement de système dans l’un des pays les plus inégalitaires au monde.

Le Chili, un pays riche
Érigé en modèle régional, le Chili est un pays riche dont tous les voyants économiques semblent au vert. Santiago doit en partie sa richesse au cuivre, dont il est le premier producteur mondial. Le pays s’enorgueillit d’une croissance ininterrompue depuis trente ans (4% en 2018, 2,5% en 2019). La quatrième économie d’Amérique latine possède une faible inflation (2% par an). Le Chili a réussi à réduire la pauvreté de 40% de la population il y a 30 ans à 8,6% aujourd’hui.
Selon l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), le Chili est le premier pays d’Amérique latine en termes de croissance économique stable et de normes en matière d’éducation et d’innovation. Son revenu par habitant est supérieur à 20 000 dollars par an. Présenté par Piñera comme une oasis de stabilité dans une Amérique latine en ébullition, le Chili présente pourtant des inégalités sociales abyssales héritées du modèle économique ultralibéral mis en place sous Pinochet et jamais remis en cause depuis la fin de la dictature.
L’ultralibéralisme des “Chicago Boys”
Le Chili est le premier État où ont été appliquées les recettes de la doctrine néolibérale portée par les “Chicago Boys”, disciples de l’économiste américain Milton Friedman. Issus de l’Université catholique de Santiago, établissement privé de la bourgeoisie avec lequel plusieurs universités américaines – dont Harvard – avaient des conventions, ces économistes chiliens ont, dans les années 1970, été chargés, par le général Pinochet, de redresser l’économie du Chili. Les “Chicago Boys” mettent ainsi en place un ensemble de mesures économiques de libéralisation, imposant un marché libre avec le soutien des États-Unis. La rencontre du néolibéralisme et de la dictature enfante la “thérapie de choc”, selon les mots de Friedman.
Les recettes de l’économiste américain sont appliquées à la lettre : privatisations, réduction du rôle de l’État et libéralisation de l’économie sont à l’ordre du jour. L’on assiste à la réduction de la dette et des dépenses publiques, au gel des salaires, à la privatisation de l’éduction, de la santé, de l’eau. Grâce à ces principes, le Chili affiche un taux de croissance qui dépasse les 5% et est qualifié de “miracle”. Pourtant, ce modèle, qui a survécu aux gouvernements successifs, est aujourd’hui arrivé à son terme.
Un système créateur d’inégalités
Le prétendu “miracle économique” a en réalité engendré un gouffre social. Selon un rapport du World Bank Group, le Chili figure parmi les dix pays les plus inégalitaires au monde. Si le revenu par habitant est élevé, il est très mal réparti. En ce sens, le Chili se classe 113e sur 128 pays selon l’Organisation des Nations Unies (ONU). 1% de la population accapare 26,5% du PIB chilien. A contrario, les 50% les plus pauvres ne se partagent que 2% des richesses.
Alors que le salaire minimum équivaut à 370€, le coût de la vie est semblable à celui de l’Europe occidentale. La libéralisation à outrance des secteurs publics fait que tout se paye. Ainsi, aller à l’université coûte cher. Il faut compter en moyenne 300€ par mois. En 2006 et 2011, plusieurs mouvements étudiants ont eu lieu pour une éducation gratuite et de qualité. Les étudiants sont endettés, avec un système qui prévoit le remboursement par prélèvement automatique dès la première embauche. Au Chili, sur 14 millions d’adultes, plus de 11 millions sont endettés.
La crise sociale est aussi sanitaire. L’austérité mine le service public hospitalier. Seule une minorité de Chiliens bénéficie d’hôpitaux privés de qualité. Les remboursements de santé, assurés par des assurances privées, sont minimes. Le système de retraite par capitalisation AFP, hérité de Pinochet et très critiqué, n’offre bien souvent qu’une retraite inférieure au salaire minimum. Alors que 10% de leur salaire est ponctionné, les Chiliens ne touchent pas le quart de leur cotisation. Si le taux de pauvreté a baissé depuis 30 ans, on estime aujourd’hui que 36% de la population urbaine vit dans une pauvreté extrême.

Chili : élites et mépris de classe
Surtout, les Chiliens dénoncent les privilèges d’une minorité qui accapare les richesses du pays. L’élite concentre le pouvoir économique, politique et institutionnel. Cette “trinité” est à l’origine d’une importante fracture entre la population et les dirigeants. Cela alimente le sentiment d’endogamie et de mépris de classe de la part des élites. En ce sens, le président Piñera est particulièrement représentatif d’une élite bien née.
Fils d’ambassadeur et neveu du président de la Conférence des évêques du pays, il a été formé dans les meilleures écoles du Chili, puis à Bruxelles et à Harvard. Piñera incarne la collusion entre milieux d’affaires, économistes libéraux et armée. Il a fait fortune dans les banques et les compagnies aériennes. Il possède aujourd’hui la cinquième fortune du pays (estimée à 2,3 milliards d’euros en 2017). Son frère, José Piñera, fait partie des “Chicago Boys”. Ministre de Pinochet, il a mis en place le système de retraite du Chili.
La population chilienne s’oppose désormais à une classe dirigeante qui souffre d’un manque de légitimité. Plusieurs scandales ont éclaboussé la classe dominante ces dernières années. La classe politique a été impliquée dans les scandales politico-financiers de 2015. Les militaires sont accusés de détournements de fonds, et de graves cas d’abus sexuels ont été révélés au sein de l’Église chilienne. La crise sociale est ainsi également une crise qui touche les principales institutions, discréditées ces dernières années. Le peuple veut en finir avec l’alliance politique nommée “Concertación”, mise en place au départ de Pinochet, qui s’est donnée pour mission d’assurer le fonctionnement institutionnel sans remettre en cause le néolibéralisme.
Une crise multidimensionnelle
La mobilisation revêt un caractère transversal. La crise est multidimensionnelle et est constituée d’une convergence de revendications de crises multiples. Si la hausse du prix du ticket de métro a déclenché la crise, le malaise est sous-jacent depuis plusieurs années. Les racines de la crise sont profondes, ancrées dans le système hérité de la dictature. Depuis les années 2000, plusieurs mouvements auraient dû alerter sur l’ampleur des problèmes sociaux. Etudiants et retraités sont descendus dans la rue à plusieurs reprises. En 2018, l’on a assisté à une forte mobilisation féministe. La population chilienne critique aussi la négation des droits d’une partie du peuple. L’armée a réprimé plusieurs mouvements indigènes dans le sud du pays.
Il faut ajouter à cela une crise environnementale qui se cristallise autour du droit à l’eau. De nombreuses mobilisations ont eu lieu contre l’accaparement de l’eau par les grandes entreprises minières et agricoles. À Quintero, la zone industrielle et portuaire relâche des gaz et produits chimiques qui intoxiquent la ville. L’agriculture intensive est une autre part du problème. Dans la région de Petorca, où l’on cultive l’avocat, plusieurs propriétaires ont détourné des rivières pour alimenter leurs exploitations. Cela a provoqué un important stress hydrique dans la région, que les habitants quittent peu à peu.
Les revendications des manifestants représentent donc une confluence de revendications et d’identités politiques, ayant trait à la fois à des questions de redistribution des richesses, aux droits sociaux et politiques, ou encore au “droit à la dignité” et à la reconnaissance des droits des peuples indigènes. La crise déclenchée le 18 octobre illustre un retour fracassant du peuple comme acteur central de la vie politique chilienne. Des assemblées citoyennes, appelées “cabildos abiertos”, voient le jour dans plusieurs quartiers.
Le gouvernement dans l’impasse face aux conséquences économiques et internationales de la crise
Le gouvernement doit désormais trouver un moyen de combler la brèche sociale qui alimente malaise et violences. Il doit pour cela jouer son rôle de protection, avec des services publics de qualité. Cela présuppose des modifications de la Constitution ultralibérale de 1980 qui limite le rôle de l’État dans l’économie. La création d’une Assemblée constituante pourrait aussi être une sortie de secours pour le gouvernement. Cette idée fait cependant face à un vide juridique au Chili : ici aussi, il faudra modifier la Constitution.
Pour le gouvernement de Piñera, il devient urgent de remédier à la crise, d’autant que les conséquences économiques et internationales commencent à se faire sentir. Le Chili s’est retiré de l’organisation de la Conférence pour le climat COP25 et du forum de Coopération économique pour l’Asie-Pacifique. Ces deux conférences internationales majeures devaient se tenir les 16 et 17 novembre pour l’APEC, en décembre pour la COP25. La sécurité de ces deux sommets ne pouvait plus être assurée, a expliqué le gouvernement. L’annulation de ces rencontres, qui devaient être une vitrine du Chili, est un coup dur pour l’industrie touristique chilienne.
La crise a également affecté l’économie chilienne. La bourse de Santiago a perdu près de trois points. Le peso est tombé à son plus bas taux par rapport au dollar depuis 2003. Un dollar équivaut désormais à 783 pesos. Les dommages de la crise atteignent au moins 1,4 milliard de dollars. Près de 7 000 entreprises sont concernées par les destructions, les pillages ou les incendies. Le tout nouveau ministre des finances, Ignacio Briones, a déclaré que la crise générerait une “diminution des investissements”, ajoutant qu’il serait nécessaire de réviser la prévision de croissance de 2,5% pour 2019.

Au Chili, le football à l’arrêt
Le sport n’est pas en reste. La finale de la Copa Libertadores – l’équivalent de la Ligue des Champions – se déroulera finalement à Lima (Pérou). L’Association nationale de football professionnel (ANFP) a décidé le report de quatre journées de Primera División de football. Alors que l’ANFP annonçait le retour du football la semaine prochaine, les principaux groupes de supporters du pays s’y sont opposés. Les barras bravas de plus de la moitié des équipes professionnelles du pays ont appelé au boycott du championnat. Los Panzers, la barra de Santiago Wanderers de Valparaíso, a ainsi publié un communiqué dans lequel elle dénonce “la tentative désespérée” du gouvernement “d’éteindre la flamme de chacun des combattants, une tentative désespérée d’obliger les gens à oublier l’objectif et la direction. Ils veulent juste donner aux gens une distraction pour baisser les bras dans cette bataille”.
Pour la Garra Blanca, les supporters du club Colo-Colo (Santiago) très impliqués dans toutes les mobilisations menées à Santiago, le gouvernement veut “donner un sentiment de normalité à travers le football et créer une fausse réalité”. Le message des barras bravas, repris par les Ultras Kanarios (San Luis de Quillota), est clair : “Sans justice sociale, il n’y aura pas de paix sociale. Ni de football”. De quoi inquiéter le gouvernement, quand l’on sait que les groupes de supporters de football sont bien souvent au cœur et aux avant-postes de la contestation, au Chili et ailleurs.