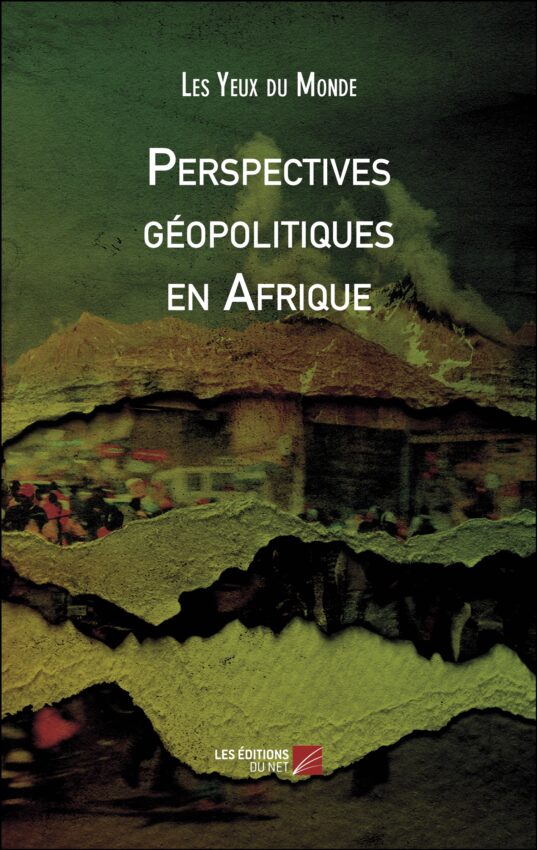Géopolitique des fonds souverains

Depuis la création en 1953 du Koweit Investment Board, le premier des fonds souverains, ces derniers se sont multipliés et sont sortis de leur fonction première de réinvestissement des surplus financiers dégagés par les Etats détenteurs de ressources naturelles. Les avoirs de ces Sovereign Wealth Funds seraient évalués à 5 820 milliards de dollars en 2013 et cet immense pouvoir financier pose ainsi la question de la volonté politique qui sous-tend leurs stratégies d’investissement. Comme l’a exprimé Angela Merkel : « La question est de savoir si la prise de participation d’un fonds doté de capitaux publics n’est pas lié à une volonté d’exercer une influence politique ».
La première génération de fonds souverains est née de la volonté des Etats dégageant de gigantesques excédents commerciaux par leurs exportations d’hydrocarbures de faire fructifier dans le temps cette manne appelée à se tarir. Ce fut le cas du Koweit avec la Kuwait Investment Authority (ex Koweit Investment Board), du Qatar avec la Qatar Investment Authority, des Emirats Arabes Unis avec la Abu Dhabi Investment Authoriy et de la Norvège avec le Government Pension Fund-Global – le plus important fonds souverain du monde avec des actifs évalués pour un montant de 878 milliards de dollars. Une deuxième génération de fonds souverains est apparue avec l’émergence de puissances commerciales nouvelles comme la Chine (China Investment Corporation), Singapour (Temasek et GIC) ou la Russie (Fonds de stabilisation de la Fédération de Russie). La différence avec la première génération tient moins à la nature des flux qui alimentent ces fonds souverains – la dichotomie ressources des hydrocarbures/excédents commerciaux industriels ne tenant pas devant l’exemple russe – mais à la nature des puissances politiques qui les contrôlent. En effet, c’est avec cette deuxième génération de fonds que s’est posée pour la première fois la question de la géopolitique des fonds souverains lorsque des acteurs comme la Russie ou la Chine ont (re)commencé à émerger sur la scène internationale – des fonds de première génération comme la QIA ont aussi suscité des interrogations à la même époque.
Car leur puissance financière, conjuguée aux effets de la crise de 2008 qui a affaiblit les économies occidentales, a permis aux fonds souverains de jouer un rôle accru dans les investissements mondiaux.
On constate ainsi à la fois des prises de participation plus stratégique et plus significatives depuis quelques années. Par exemple, des fonds souverains sont ou ont été présents dans des proportions d’entre 2 et 10% au capital de sociétés importantes comme l’ex-EADS, Daimler-Benz ou encore Total. Cela est d’autant plus marqué dans le capital des grandes banques européennes et américaines mises en difficultés par la crise où de nombreux fonds souverains sont présents – comme ADIA chez Citigroup, KIA chez Merrill Lynch et Citigroup… Ces prises de participations sont parfois couplées avec une stratégie de partenariat qui permet des retombées industrielles et technologiques au pays d’origine. On a parlé pour le Qatar et son bras financier, la QIA, de « diplomatie de l’argent » avec le rachat du Printemps ou du PSG. Dans ce cas précis il s’agissait d’une stratégie d’investissement claire et articulée sur plusieurs pays – le Royaume-Uni étant de loin préféré à la France par la QIA. Cependant, cette stratégie qatarie d’investissement dans du soft power qu’il ne peut produire seul, bien que discutable, est loin d’être la norme. Malgré une puissance financière accrue, les fonds souverains obéissent souvent plus à des logiques financières que politiques, même si le potentiel pour une utilisation stratégique existe bien.