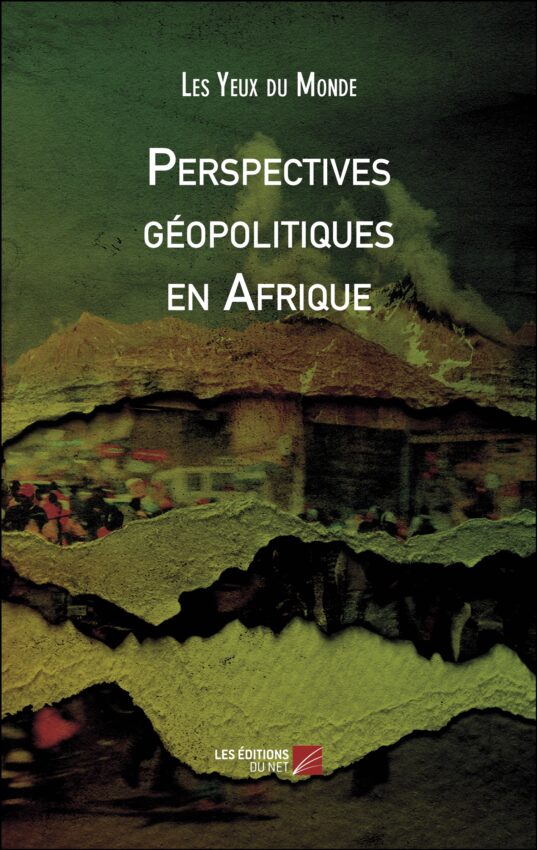La réforme du Conseil de Sécurité de l’ONU (1/2)

Les crises syriennes et ukrainiennes remettent au goût du jour ce poncif qu’est devenue la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU). Depuis l’entrée à l’ONU des nations décolonisées et la fin de la Guerre Froide, le décalage entre le nouveau contexte géopolitique et la structure de cet organe est une réalité. Si de nombreuses pistes et propositions ont été avancées, une éventuellle réforme demeure compliquée tant l’entrée d’un pays au sein du CSNU provoquerait réactions et jalousies d’autres nations concurrentes.
Le CSNU se compose, depuis 1963, de 15 membres, dont 5 permanents (France, USA, Royaume-Uni, Chine et Russie) disposant d’un droit de veto sur toute proposition de résolution. Les dix autres membres sont élus tous les deux ans par l’Assemblée Générale (AG), avec des quotas à respecter correspondant aux cinq grandes régions du monde. L’AG ne disposant d’aucun pouvoir effectif, c’est le Conseil qui possède la véritable autorité puisque ses résolutions ont valeur juridique (droit dérivé) et s’appliquent à l’ensemble des États-membres. La première critique concerne donc son manque de représentativité, puisque sur 193 États-membres, quinze seulement disposent d’un pouvoir contraignant, dont cinq sont à même de censurer n’importe quelle mesure. Ce qui débouche sur la seconde critique qui est celle du manque d’efficacité. Dans certaines situations (Syrie, Ukraine), les compétences de l’ONU se trouvent limitées voire neutralisées du fait qu’un des cinq membres permanents considère une potentielle action internationale comme contraire à ses intérêts propres. De fait, au gré des situations et des intérêts, le CSNU se trouve régulièrement paralysé par la création de coalitions temporaires (qui recoupent souvent mais pas systématiquent le clivage Occidentaux / Russie, Chine) arguant tantôt du respect de la souveraineté nationale, tantôt du droit d’ingérence au nom de la défense de populations civiles.
En lieu et place d’un organe reflétant effectivement un consensus international, le Conseil apparaît donc dans les faits comme un outil au service d’Etats déjà puissants, qui, dans le vote comme dans le veto, s’en servent pour défendre leurs intérêts.
Le tableau mérite cependant d’être nuancé. En premier lieu, la médiatisation des désaccords et vetos cache une dense activité législative qui n’est pas que le fait de réactions à des événement innatendus. La lutte contre le terrorisme ou l’aide au développement font l’objet d’un travail de fond sur lequel il y a bien souvent consensus. Si les modalités d’intervention en Irak restent sujettes à controverses, les membres du CSNU partagent en ce moment un même diagnostic sur les actes de l’Etat Islamique (résolution 2170). Même dans le cas de résolutions visant à répondre à un acte imprévu, le CSNU sait se révéler efficace et unanime, comme l’illustre notamment la première guerre du Golf. Plus récemment, et bien que parfois qualifiée de néo-coloniale, la récente intervention française au Mali (qui est toujours aujourd’hui l’objet d’un suivi post-bataille) bénéficiait d’un mandat de l’ONU et était formellement réclamée par le pays concerné et ses voisins.
Héritier de l’architecture mondiale au sortir de la 2nd Guerre mondiale, le CSNU apparaît donc aujourd’hui d’une part paralysé par les nouveaux rapports de force en son sein, d’autre part injuste car imperméable à l’émergence de nouveaux Etats. De fait, si l’on peut saluer chaque décision prise unanimement et suivie d’actions effiaces, il n’en demeure pas moins qu’en cas d’urgence et sur les sujets les plus sensibles, les cinq membres permanents semblent confisquer la légitimité de l’organe international.
Si le constat d’une réforme est donc aujourd’hui grandement partagé, le défi demeure de répondre à l’exigence démocratique sans altérer pour autant une efficacité actuellement déjà intermittente.