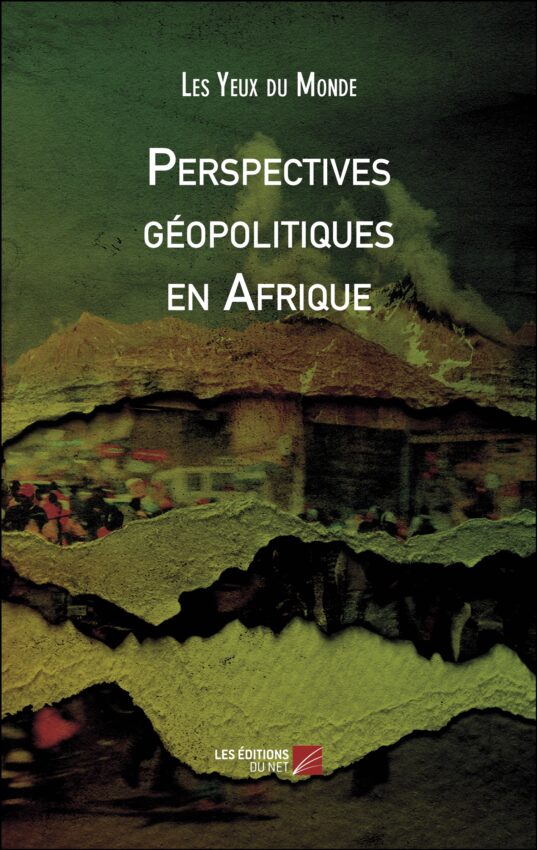Colombes, faucons et chouettes : 3 écoles de pensée des relations internationales
L’analyse des relations internationales et de la politique internationale est largement déterminée par des courants de pensées d’origine anglo-saxonne. Dans le cadre de son intervention à l’École de Guerre Économique en partenariat avec la revue Conflits, Frédéric Munier rappelle qu’il existe plusieurs écoles dont 3 se révèlent particulièrement structurantes : l’internationalisme libéral (les colombes), le réalisme (les faucons) et le constructivisme social (les chouettes). À chacune ses grands principes cadres, ses penseurs, sa période dominante et son oiseau-symbole. L’influence de ces 3 écoles a modelé la politique étrangère américaine depuis plus d’un siècle. À l’approche des élections présidentielles américaines de 2016, penchons-nous sur les fondements de la politique internationale.

Les colombes libérales
Née dans le contexte post-Première Guerre mondiale, l’école libérale est le fruit d’un besoin de contrebalancement de la surenchère meurtrière de la Grande Guerre. Les théoriciens libéraux s’inspirent notamment des philosophes des Lumières mais aussi d’Emmanuel Kant et de son essai intitulé Vers la paix perpétuelle qui, comme son nom l’indique, esquisse un « projet de paix perpétuelle » dès 1795. Les colombes libérales construisent le soubassement théorique des « 14 points de Wilson » et sont à l’origine de la création en 1919 de la Société des Nations (SDN), l’ancêtre de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Le but des libéraux est de garantir la paix et la stabilité du système international de manière durable. Pour cela, les colombes misent sur le libre-échange (libéralisme économique), la diffusion de la démocratie et de l’État de droit, le respect des libertés individuelles et du droit international.
Selon elles, l’expansion des interdépendances économiques entre les États et le règlement des contentieux par le droit international et la diplomatie permettent de minimiser le risque de guerres futures. Les colombes libérales développent une forme d’horizon idéaliste, partant de la cruelle réalité de l’hécatombe de 1914-1918 pour mieux concevoir le monde tel qu’il devrait être. Leur théorie place l’individu, l’humain au centre du monde ; les États ayant pour rôle de servir leur peuple au sein d’un système international partagé avec des organisations régionales et internationales tout comme des ONG. Toutefois, les colombes libérales ne sont ni naïves ni adeptes d’un pacifisme forcené. Elles conçoivent la guerre comme un ultime recours qui peut se justifier dans certaines conditions, l’empêchement d’un génocide par exemple.
Les faucons réalistes
Le réalisme en relations internationales a été développé en réaction au libéralisme. Les faucons réalistes partent du constat de l’incapacité de la SDN, fondée par les libéraux, à enrayer la montée du fascisme, du nazisme et leur funeste conséquence : la Seconde Guerre mondiale. Dans l’histoire longue, le réalisme tire ses racines de penseurs comme Thucydide, Machiavel, mais aussi Hobbes (« l’homme est un loup pour l’homme ») ou Clauzevitz qui écrit que « la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens ». Toutefois, c’est Hans Morgenthau qui fonde véritablement l’école réaliste telle que nous la connaissons grâce à son ouvrage, publié en 1948 : Politics Among Nations : the Struggle for Power and Peace. Il y énonce les piliers du réalisme : les États sont de loin les principaux architectes du système international ; ils évoluent dans un monde anarchique, les faits primant sur les principes et le droit international ; ils sont mus par la recherche permanente de la puissance ; ils agissent pour défendre leurs intérêts notamment par le moyen de la diplomatie secrète et par la guerre ; le monde des faucons réalistes n’est pas régi par le droit international mais par l’équilibre des puissances. L’école réaliste des relations internationales domine durant toute la Guerre froide. Proche de la realpolitik, elle influence grandement certains praticiens de la géopolitique comme Georges Kennan et Henry Kissinger.
Les chouettes constructivistes
L’école constructiviste s’est constituée en réaction aux courants réaliste et libéral à partir des années 1970 puis a connu un certain essor dans les années 1990 durant l’administration de Bill Clinton. Les chouettes constructivistes considèrent que le monde a changé : les États ne sont plus les seuls acteurs aux côtés des organisations internationales mais sont maintenant de plus en plus concurrencés par des ONG, des associations, les médias, les firmes multinationales, les groupes armés terroristes ou encore les mafias. Par conséquent, les grilles de lecture des relations internationales développées par les écoles antérieures sont désormais obsolètes. Joseph Nye, doyen d’Harvard, est un des grands penseurs du constructivisme social. En opposition à l’universitaire britannique Paul Kennedy qui affirme en 1987 dans son essai The Rise and Fall of Great Powers que les États-Unis connaissent un déclin irrémédiable à l’image de tous les grands empires du passé, Joseph Nye pronostique au contraire que la puissance américaine a encore de beaux jours devant elle.
Il introduit le concept de soft power et affirme que la nature de la puissance a changé. Tandis que Paul Kennedy ne prend en compte que la puissance coercitive (hard power), Nye affirme que les éléments intangibles de la puissance (le soft power) comme l’histoire, la culture, l’attractivité, le façonnement des identités, le storytelling, l’influence et la séduction sont au moins aussi importants dorénavant pour bâtir une véritable puissance. Reprenant le concept de « smart power » forgé par la diplomate américaine Suzanne Nossel, Joseph Nye affirme que les États-Unis continueront à dominer le monde s’ils parviennent à combiner de manière permanente et intelligente le hard power et le soft power. Conseiller proche de John Kerry (il était pressenti pour devenir secrétaire d’État si Kerry remportait les élections face à Bush fils en 2004), Joseph Nye a largement inspiré la doctrine Obama et la politique étrangère du « smart power » menée par Hillary Clinton de 2008 à 2012.