« La présence américaine conventionnelle au Moyen-Orient reste impressionnante »
Madjid Zerrouky, journaliste au quotidien Le Monde, est spécialiste du Moyen-Orient et du Maghreb. Il analyse aujourd’hui les grands traits de la politique des Etats-Unis au Moyen-Orient.

Les principaux intérêts des Etats-Unis au Moyen-Orient ont-ils évolués ?
Non, ce sont toujours les mêmes. Même si les importations américaines de pétrole sont au plus bas du fait de l’explosion de leur production de pétrole de schiste. Leurs alliés, et surtout l’équilibre de l’économie mondiale, continue de dépendre en grande partie de la production de la région.
Le Moyen-Orient est enfin et surtout un axe de navigation majeur en termes de routes commerciales et la région reste, dans l’esprit de Washington, à portée de tir de ses « ennemis naturels et historiques » : la Russie et l’Iran (qui en fait partie). Et bientôt de la Chine, qui se rapproche, y compris militairement, avec l’ouverture d’une base à Djibouti.
La politique de Trump au Moyen-Orient s’inscrit-elle réellement en rupture avec celles de ses prédécesseurs ?
En tout cas, elle est clairement en opposition avec celle de son prédécesseur ! La politique américaine au Moyen-Orient se réduit de plus en plus à la lutte contre l’Iran et à la constitution d’une alliance entre pétromonarchies et Israël pour contrer Téhéran, voire parvenir à y changer le régime.
Mike Pompeo a parlé en janvier d’un « réel nouveau départ » : une expression empruntée à Obama pour mieux dévitaliser la politique américaine antérieure. Barack Obama, en son temps, avait choisi de tendre la main pour solder les années désastreuses qui avaient suivi l’invasion de l’Irak, les dérives de la « guerre contre le terrorisme »…
L’ancien président avait été l’artisan d’un rapprochement avec l’Iran via l’accord historique sur le nucléaire de juillet 2015, que Donald Trump s’est empressé de déchirer pour revenir à une politique de confrontation. Et si les Etats-Unis n’ont jamais été un acteur neutre dans les négociations israélo-palestiniennes, ils sont désormais complètement alignés sur les positions de leur allié israélien. Avec le plus beau des gages : le transfert unilatéral et sans contrepartie de leur ambassade à Jérusalem.
Quant à la question des libertés, voulues par Obama comme un socle de sa politique étrangère, on a pu voir, avec l’affaire Khashoggi ou les hommages appuyés au maréchal Sissi, à quel point cet aspect n’avait plus cours.
En Syrie par contre, Donald Trump a agi contre Damas. Contrairement à son prédécesseur, qui n’a pas bougé quand le régime a eu recours aux armes chimiques alors même qu’il en avait fait une « ligne rouge ».
La décision de Trump de se retirer de Syrie risque-elle d’accentuer la présence iranienne en Syrie ?
En théorie oui. Mais il faut voir exactement ce qu’il en est. Les Etats-Unis annoncent aujourd’hui le maintien de 200 hommes au sol. Une présence symbolique suffisante pour empêcher un retour des forces de Damas et pro-iraniennes dans le nord-est et le sud-est.
Si tant est qu’il y ait la volonté réelle de les en empêcher à terme et que la Turquie n’intervienne pas dans le nord contre les Forces démocratiques syriennes, alliées de Washington sur le terrain. Cela fait beaucoup de si… Reste la présence américaine en Jordanie et surtout Israël. Tel-Aviv a en effet mené plus de 200 frappes contre des cibles iraniennes ces dernières années.
Pendant la Guerre Froide, puis durant l’intervention en Irak, les États-Unis se sont beaucoup appuyés sur la Jordanie, pays discret mais pays pilier. Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?
Les signaux sont contradictoires. Et cela se traduit y compris par un affaiblissement diplomatique de la Jordanie au niveau régional. La Jordanie, acteur historique des négociations de paix israélo-palestiniennes et favorable à une solution à deux Etats, a vécu comme une gifle la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d’Israël. D’autant plus que, symboliquement, elle garde la souveraineté sur les biens du Waqf, donc les lieux saints, et plus de la moitié de sa population est d’origine palestinienne.
Si l’aide américaine reste soutenue – de l’ordre de 1,3 milliard de dollars par an-, et même si un très timide retour est à l’œuvre, la Jordanie ne s’en sort pas. Son économie est à bout de souffle et elle fait face quasiment seule à la présence de centaines de milliers de réfugiés syriens. Amman a d’ailleurs connu en juin dernier un mouvement de protestation inédit contre la politique d’austérité du gouvernement. La crise n’a été surmontée que grâce à l’intervention des pays du Golfe. On peut cependant douter que l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, par exemple, soient complètement désintéressés et il est probable qu’avec le temps, ils demandent des contreparties diplomatiques à Amman.
D’un autre côté, le royaume garde un intérêt stratégique pour les Etats-Unis dans le cadre de la politique de l’endiguement de l’Iran. La base d’Al-Tanf – côté jordanien de la frontière – permet, par exemple, aux forces spéciales américaines de contrôler l’un des principaux axes routiers Irak-Syrie et de verrouiller son accès aux forces pro-iraniennes.
Existe-t-il une chance de voir dans les prochains mois un rapprochement Assad-Trump ?
Pas tant que Bachar el-Assad sera perçu comme une marionnette iranienne ou russe. C’est à court terme impossible.
Les États-Unis ont toujours entretenu une relation particulière avec la Turquie, partenaire primordiale de l’Alliance atlantique. Le rapprochement de la Turquie avec la Russie annonce-t-il un virage dans les relations de Washington avec Ankara ?
Les relations entre Ankara et Washington sont exécrables. Mais je ne suis pas sûr qu’il soit dans l’intérêt du président Erdogan de s’engager encore davantage dans cette voie. S’engager dans une crise politique et une guerre commerciale avec l’administration américaine serait suicidaire. L’économie turque va mal et Ankara a besoin d’emprunter en dollars de quoi financer son déficit budgétaire, de 7 % l’an passé, sur les marchés mondiaux. De ce côté-ci de l’équation, Moscou n’a rien à lui offrir. Même si la Russie est un partenaire de premier plan au niveau régional dans l’affaire syrienne.
Existe-il une évolution de la perception des États-Unis par les populations des pays arabes ?
C’était le cas sous les années Obama, même s’il a beaucoup déçu. Avec Trump, la perception repart en sens inverse. Dans le négatif.
Est-ce que la politique des États-Unis au Moyen-Orient glisse vers celle qui existe déjà en Afrique ? C’est-à-dire une politique du « light footprint », de l’empreinte légère, davantage conduite par des opérations de forces spéciales discrètes que par un déploiement de troupes massif ?
Je ne pense pas. Les effectifs conséquents engagés au sol sont avant tout héritiers des années post-invasion de l’Irak puis de la lutte contre Al-Qaida. Les circonstances aujourd’hui ne nécessitent plus la présence de dizaines de milliers d’hommes, même si 5 000 hommes vont rester en Irak, ce qui n’est pas rien. Il faut regarder l’ensemble du tableau. Dans les airs – via leurs bases aériennes dans la région – et surtout en mer, la présence américaine conventionnelle reste impressionnante.


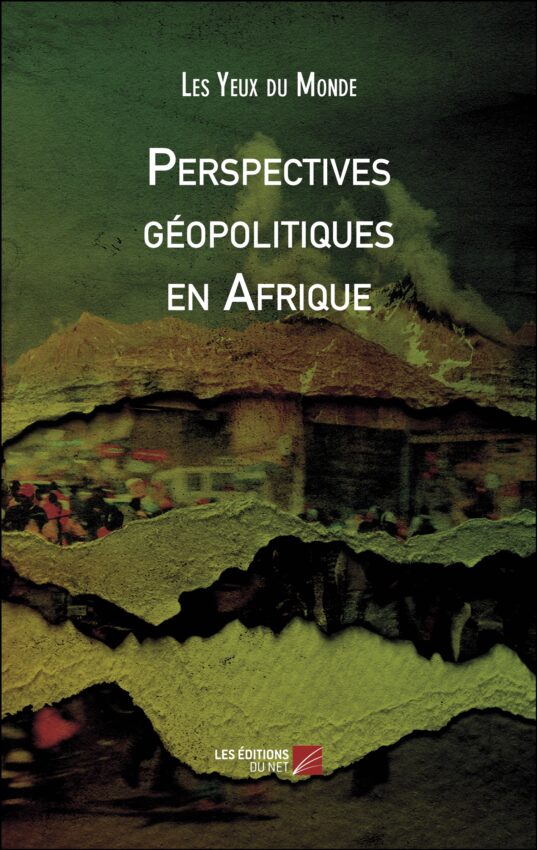
Ping : La présence américaine au Moyen-Orient après le coronavirus - Le Grand Continent