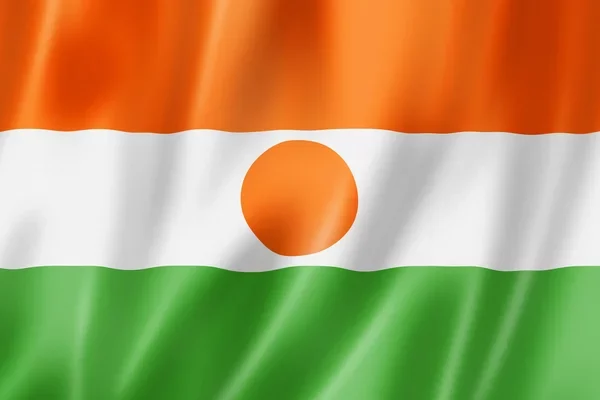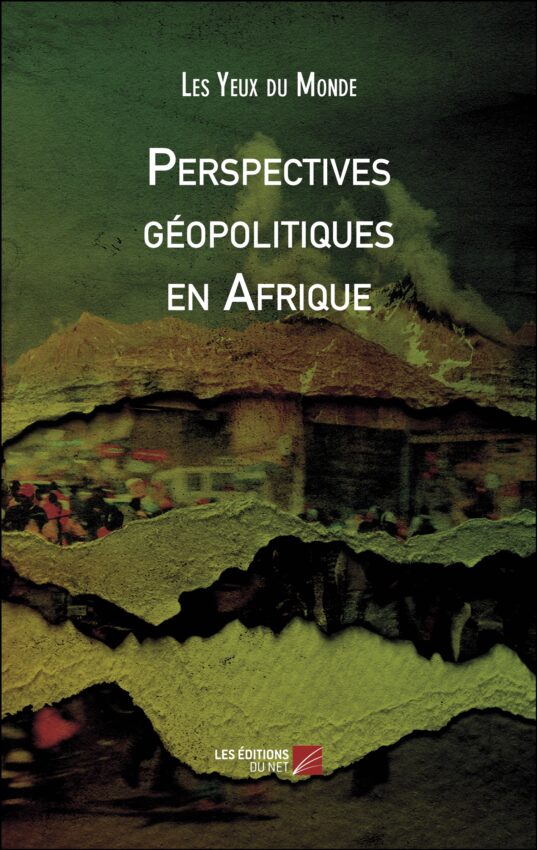Anatomie d’un coup d’État : étude de cas au Niger (1/4)
Depuis 2021, six coups d’État ont eu lieu sur le continent africain : au Soudan, au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina-Faso, au Niger et au Gabon. Le déficit de gouvernance et l’échec des élites politiques dans la réalisation des attentes et objectifs de leurs populations en sont des fondements patents. Le 26 juillet 2023, un coup d’État inattendu renversa le désormais ex-président Mohamed Bazoum. Le général Abdourahamane Tiani, commandant de la garde présidentielle, prit alors la tête du pays. C’est un nouveau coup d’État perpétré en Afrique de l’Ouest et il convient d’en analyser l’origine, ses causes et conséquences, au Sahel et pour la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
La fin du mois d’août 2023 vit un nouveau coup d’État se produire, cette fois-ci au Gabon.

(Licence CC).
Le contexte précédant le coup d’État
Ce coup d’État semble avoir de multiples origines. En effet, plusieurs hypothèses permettent d’appréhender au mieux les raisons conduisant à ce changement forcé de régime. Ces hypothèses proviennent aussi bien du camp des putschistes que de celui de l’ex-président.
Le 26 mai 2023, l’ex-président Bazoum donnait une interview dans laquelle il lui était demandé sa position concernant la mobilisation des populations civiles au sein de l’armée pour lutter contre les groupes terroristes. Cette stratégie est appliquée, par exemple, au Burkina Faso, avec les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Mohamed Bazoum donna alors une réponse pour le moins cinglante. Selon lui, « ces terroristes sont plus forts que nos armées, plus aguerris ». Il poursuivit son développement en indiquant que cela ferait des populations civiles enrôlées des proies faciles pour les terroristes.
Ces propos ont été particulièrement mal accueillis tant par les militaires que par la garde présidentielle.
La décision de relâcher des terroristes, dont des membres de Boko Haram, précédemment capturés, dans le but de « rechercher la paix » dans le pays, a également été mal perçu par les militaires. Ce sont deux des principales motivations qui justifient le coup d’État, selon les putschistes. Les autres justifications portent sur la « dégradation de la situation sécuritaire » et la « mauvaise gouvernance ».

Une nouvelle compagnie pétrolière nationale comme argument
Une autre explication tient à la volonté du président déchu Bazoum de créer une nouvelle compagnie pétrolière, PétroNiger. Cette compagnie devait gérer l’exportation des produits pétroliers du Niger. Elle devait remplacer les précédentes compagnies existantes et particulièrement, la Société nigérienne du pétrole (SONIDEP). Celle-ci était accusée d’être une caisse noire pour le parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS). De plus, des accusations de financement illégal en direction d’une partie de l’armée existaient. Après un audit mené par le Fonds monétaire international (FMI), constatant un possible détournement de fonds (entre 50 et 60 millions de dollars par an), Mohamed Bazoum prit alors la décision de neutraliser la SONIDEP en créant PétroNiger. Toutefois, il n’eut pas le temps de valider la création de la nouvelle entreprise, prévue le 27 juillet 2023, soit le lendemain du coup d’État.
Dans les mois précédant le coup d’État, Mohamed Bazoum souhaitait changer le commandant de la garde républicaine. Il semblerait qu’une promesse faîte à l’ancien président Issoufou par Bazoum existait à ce sujet. En effet, Issoufou voulait que Tiani soit maintenu à son poste. La volonté présidentielle de changement a peut-être précipité la perpétration de ce coup de force.
Le général Tiani s’empara du pouvoir et mit en place le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). M. Bazoum, refusant de démissionner, fut placé en détention au palais présidentiel, en compagnie de son épouse et de leur fils.
La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union africaine (UA) n’ont pas tardé à réagir après ce coup d’État, en le condamnant fermement et en prenant des sanctions d’une rare sévérité.
CEDEAO et UA : entre voie diplomatique et potentiel recours à la force
En réponse au coup d’État, la CEDEAO a voulu envoyer un message sans ambages aux nouvelles autorités au pouvoir. L’imposition rapide et la rigueur des sanctions ne poursuivaient qu’un seul objectif : rétablir l’ordre constitutionnel à Niamey.
La CEDEAO, par l’intermédiaire de sa Conférence des chefs d’État et de gouvernement (CCEG), dirigée par le président nigérian et président en exercice de la Conférence, Bola Ahmed Tinubu, a choisi d’introduire des sanctions portant sur un large éventail. L’utilisation des sanctions permet à l’organisation ouest-africaine de se situer au-dessus de la voie diplomatique mais en-deçà du recours à la force.
En l’espèce, par un communiqué du 30 juillet 2023, la CEDEAO acte les mesures appliquées contre le Niger. Celles-ci sont au nombre de neuf, les plus significatives étant les suivantes :
- Fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger.
- Suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Niger.
- Gel des avoirs du Niger dans les banques centrales de la CEDEAO.
- Gel des avoirs de l’État du Niger, ainsi que des entreprises publiques et parapubliques.
Le Nigéria, qui fournit près de 70 % des besoins en électricité au Niger, a également interrompu cette livraison. Les conséquences de ces mesures ont été rapidement ressenties au sein de la population. Dans l’un des pays les moins riches d’Afrique, de telles mesures conduisirent à l’inflation, au manque conséquent de denrées alimentaires et de médicaments. L’aide humanitaire extérieure s’est retrouvée bloquée, les frontières étant fermées.
La CEDEAO décida de la levée des sanctions économiques, commerciales et de voyage en février 2024. L’organisation régionale indiqua qu’elle procèdait ainsi pour motif « humanitaire », afin d’atténuer les souffrances du peuple nigérien.
Des sanctions légales ?
Dans un tel contexte, il paraît adéquat de questionner la légalité des sanctions prises par la CEDEAO.
Tout d’abord, il est important de se demander si la CEDEAO, organisation de coopération économique à l’origine, peut établir des sanctions en dehors de ce cadre.
Ni le Traité original de 1975, ni le Traité révisé de 1993, n’indiquent explicitement la possibilité de prendre toutes sortes de sanctions. En effet, l’article 77 du Traité révisé de la CEDEAO prévoit des sanctions en cas de manquement à des obligations vis-à-vis de la Communauté. Ces sanctions peuvent être prises par la Conférence. Elles concernent la suspension de l’octroi de tout nouveau prêt, la suspension du droit de vote et la suspension de la participation aux activités de la Communauté.
Il est alors possible de se demander si les sanctions contre le Niger sont tirées d’une interprétation stricte des Traités ou d’une lecture extensive de ceux-ci. Ainsi, ces sanctions seraient-elles décidées sans réelle base légale ?
C’est donc un cadre juridique flou qui entoure ce régime de sanctions en l’espèce.