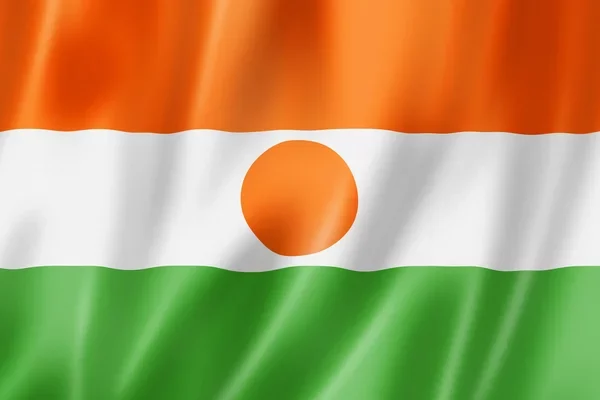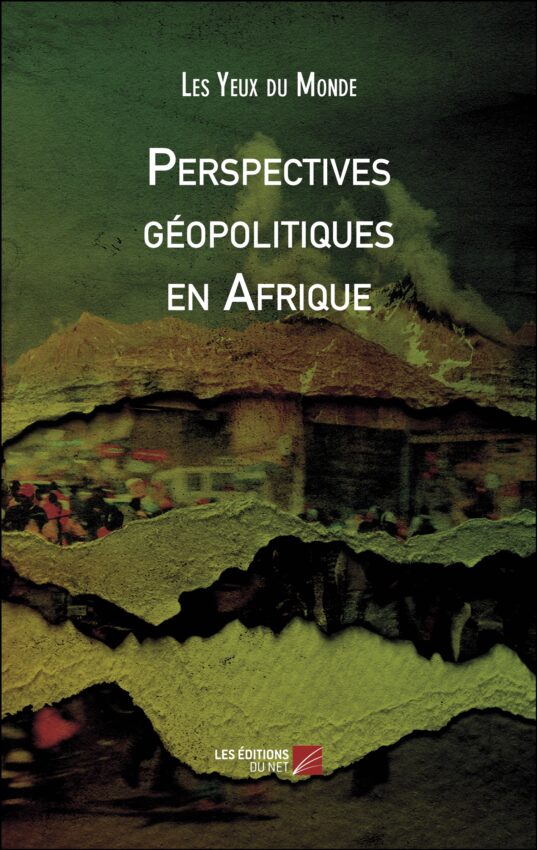Anatomie d’un coup d’État : étude de cas au Niger (3/4)
Après l’imposition de sanctions et la menace d’une intervention militaire, le Niger prit le parti de rejoindre une alliance militaire défensive, l’Alliance des États du Sahel (AES). Les manifestations populaires et le rejet des armées françaises interrogèrent sur un possible « sentiment anti-français ».

Passe d’armes diplomatique entre le Niger et la France
La déflagration causée par le coup d’État nigérien a été ressentie bien au-delà du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Les nouvelles autorités nigériennes décidèrent de dénoncer les accords de défense datant de 1977 et liant la France au Niger.
La France opposa son refus, arguant que le nouveau régime n’était pas légitime. Cette passe d’armes diplomatique atteignit un sommet, lorsque les nouvelles autorités de facto déclarèrent « persona non grata » l’ambassadeur de France au Niger, Sylvain Itté.
La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 prévoit, dans de tels cas, que l’État accréditant (ici, la France), doit « rappeler la personne en cause ou mettre fin à ses fonctions auprès de la mission » (article 9). La France est signataire de cette convention et l’a ratifiée, le Niger y a adhéré. Toutefois, la présidence française prit la décision de ne pas rapatrier son ambassadeur. La position française a été accentuée par le soutien du président français Emmanuel Macron à l’éventuelle intervention militaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au Niger, en dehors d’un cadre juridique clair. Celui-ci indiquait alors, lors d’un discours prononcé à l’occasion de la Conférence des ambassadeurs, en août 2023, qu’il ne devait y avoir « ni paternalisme, ni faiblesse, sinon, on n’est plus nulle part ».
Cette posture de fermeté adoptée par la France l’éloigna ainsi de toute solution négociée et apaisée avec le Niger. Cette attitude est d’autant plus saisissante qu’à la différence de la France, les États-Unis et d’autres pays européens adoptèrent une approche plus diplomatique et pragmatique.
Après plusieurs semaines, la France changea finalement de doctrine et rapatria son ambassadeur.
Le général Tiani décida également, de manière unilatérale, du départ des troupes françaises présentes sur le territoire nigérien. Cette éviction s’accompagnait d’une date limite, celle de décembre 2023. Niamey renvoya également les troupes américaines.
« Sentiment anti-français » et volonté de l’opinion publique nigérienne
Cette décision nigérienne fut alors appréhendée comme une rémanence du spectre du « sentiment anti-français » au Sahel. Plus largement, c’est aussi l’analyse retenue pour l’Afrique de l’Ouest (francophone).
Le « sentiment anti-français » correspondrait ainsi à une forme de rejet de la France par les opinions publiques africaines. Il a pu se manifester notamment par des manifestations soutenant et réclamant le départ des troupes françaises.
En France, la grille de lecture retenue pour expliquer l’émergence de ce sentiment anti-français est celle de la guerre informationnelle. En effet, ce sentiment serait le résultat d’une opération d’influence russe (et la présence de drapeaux russes lors des manifestations en soutien au régime de Tiani en constituerait la preuve). Bien qu’il soit avéré que la Russie (et d’autres acteurs internationaux, tels que la Chine) use et finance des techniques de guerre hybride (désinformation), il serait toutefois incomplet d’attribuer les causes de ce rejet de la présence française uniquement à des opérations de désinformation. Surtout, cela pourrait conduire à penser que les populations locales sont très vulnérables, malléables et facilement manipulables.
Or, au Niger, il n’y eut d’attaques ni contre les citoyens français, ni contre les entreprises présentes sur place. Évoquer de ce fait la notion de « sentiment » peut également être une manière d’atténuer les raisons profondes expliquant ce rejet.
Les opinions publiques de certains pays africains, indépendantes d’esprit, rejettent la France sur la base de plusieurs arguments. Ceux-ci sont d’ordre internes et externes aux pays.
Les racines du rejet
En interne, les nombreuses entreprises étrangères (dont des françaises) présentes au Niger ou ailleurs en Afrique de l’Ouest s’enrichissent et extraient des ressources dans ces pays. Toutefois, toutes ces richesses créées profitent uniquement à certains dirigeants et à leurs entourages, détournant, par conséquent, des sommes colossales (prévarication et favoritisme). Celles-ci ne profitent donc que marginalement aux populations, à l’amélioration des conditions de vie et aux infrastructures, ainsi qu’au développement général des économies. Le sceau de l’inéfficacité frappe ainsi les dirigeants renversés.
À l’extérieur, le rejet de la France est nourri par une forme de lassitude ressentie par la population, du fait de la présence des forces françaises. Celles-ci sont présentes sur le territoire nigérien depuis longtemps, particulièrement dans le cadre de la lutte contre le djihadisme. Il y eut un nombre important de soldats déployés et des équipements très sophistiqués apportés sur place (notamment aériens). Néanmoins, les résultats décisifs de l’intervention française contre les terroristes se font encore attendre au Niger. En conséquence, l’armée française est perçue comme une force d’occupation. Cette perception a été renforcée par le redéploiement des forces françaises présentes au Mali et au Burkina-Faso sur le territoire nigérien, lorsqu’elles furent congédiées par les nouveaux dirigeants en place dans ces deux pays précités.
À cela s’ajoute un ressentiment colonial encore très présent, consécutif aux nombreuses ingérences dans la vie politique, particulièrement après les indépendances des années 1960. Les interventions militaires occidentales, et particulièrement françaises (en Algérie ou au Rwanda) portent encore beaucoup de traumatisme sur le continent.
Il s’agit davantage d’un rejet des politiques françaises au Niger (et en Afrique francophone) que d’un « sentiment anti-français » en tant que tel.
Retour vers une forme de souverainisme
Cette vague de rejet s’inscrit dans un mouvement plus large. Celui-ci sonne la fin de la « mondialisation heureuse » dans différentes zones du monde. Il augure également un retour à la souveraineté étatique. Le contraste est important et l’incompréhension de certains pays occidentaux réside peut-être ici. La France, et plus largement, l’Europe, sont dans un mouvement contraire, à savoir celui du fédéralisme.
Ces populations réclament, en substance, un traitement sans condescendance, avec respect et sur un même pied d’égalité. D’autres acteurs, comme les États-Unis, la Russie, la Chine ou l’Allemagne, adoptent cette posture. Il existe également un objectif d’exercer de plein exercice leur souveraineté dans leurs pays et une volonté de maîtrise complète de leurs destins.
Les derniers commentaires du président français Emmanuel Macron, lors de la Conférence des ambassadeurs en janvier 2025, ne sont pas de nature à apaiser les relations. Les différents pays africains ainsi que leurs populations n’accueillèrent pas favorablement ces propos.
Il avait ainsi déclaré, par rapport au départ forcé des troupes françaises : « On a choisi de bouger en Afrique ». La réalité étant tout autre, car ce sont bien les autorités nigériennes qui ont éconduit les forces françaises.
Il ajouta, dans le cadre de l’engagement militaire français contre le terrorisme au Sahel : « Je crois qu’on a oublié de nous dire merci : c’est pas grave (sic), ça viendra avec le temps, l’ingratitude […] est une maladie non-transmissible à l’Homme ».
Ces propos ne manquèrent pas de susciter de vives réactions. Le Tchad, qui a rompu en novembre 2024 ses accords militaires le liant avec la France, et le Sénégal, ont condamné ce discours, le qualifiant de « méprisant ». Les deux pays ont expressément demandé aux forces françaises de quitter leur territoire.