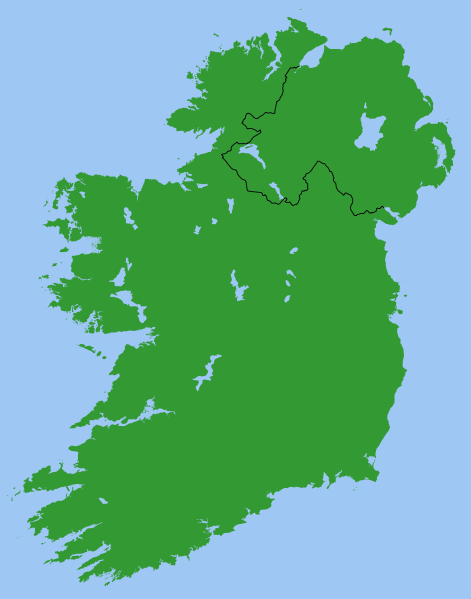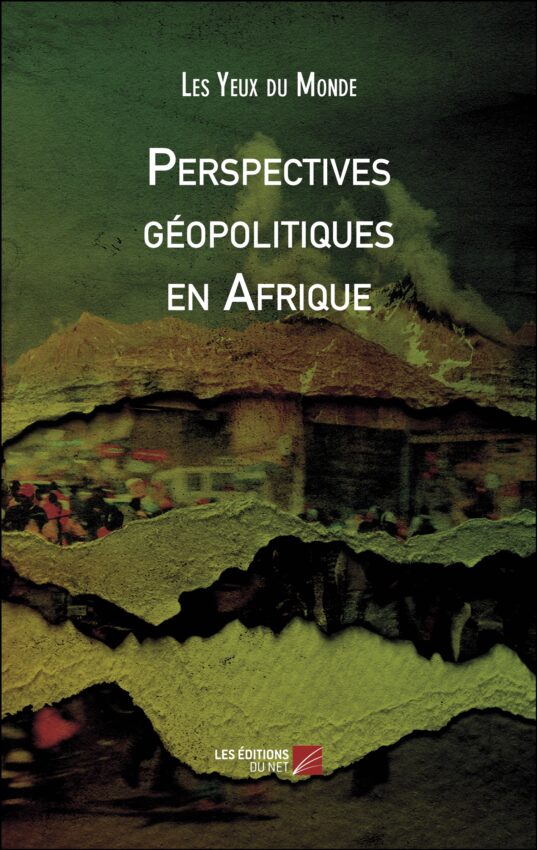Trump à l’assaut des fonds marins
Les décrets du président Trump se poursuivent sans le moindre signe de ralentissement. Le 24 avril dernier, ce fut donc au tour des fonds marins de subir les foudres du locataire tumultueux de la Maison-Blanche. En effet, dans un décret intitulé « Unleashing America’s offshore critical minerals and resources », l’administration américaine a annoncé son intention d’enfin « déchaîner » l’exploitation des fonds marins. Seulement, miner en haute mer reste illégal au regard du droit international. Cette décision risque donc de lever des sourcils… avant peut-être de faire des émules.
Quel droit pour les fonds marins ?
De par la nature des océans, le droit de la mer est principalement un sujet de droit international. Si les droits nationaux peuvent s’appliquer dans les zones côtières, c’est d’abord en conformité avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). En haute mer, cette zone où aucun État n’a de juridiction et qui couvre 64 % des océans, la convention onusienne sert de bible pour déterminer ce que les États peuvent faire ou non. Si ce traité international est en vigueur depuis 1994, deux points apportent tout de même de la nuance. Premièrement, le régime d’exploitation des fonds marins au-delà des juridictions nationales (c’est-à-dire sous la haute mer) est toujours en cours de négociations suivant les bases établies par le traité. Deuxièmement, les États-Unis n’ont jamais ratifié la CNUDM.
Un régime toujours en négociations

L’exploitation des fonds marins riches en minéraux est un vieux rêve de l’humanité. Bien qu’il fût encore loin d’être réalisable lors des négociations de la CNUDM, l’inquiétude était déjà là de voir les pays riches aux capacités technologiques plus avancées, s’approprier les ressources du plancher océanique sur un modèle « premiers arrivés, premiers servis ».
Un accord fut donc trouvé pour considérer les ressources minières de cette aire au-delà de toute souveraineté étatique comme le « Patrimoine commun de l’Humanité ». Cet espace est depuis intitulé « la Zone » et tombe sous la compétence de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM). Celle-ci a la charge d’établir les règles relatives à l’exploitation des ressources mais aussi la faculté de délivrer les permis nécessaires pour commencer les opérations.
Seulement, les négociations patinent depuis des années. Le code minier n’existe toujours pas et les appels allant de la pause à durée indéterminée à l’interdiction pure et simple se multiplient. Face à cette stagnation, la patience de ceux qui voudraient révolutionner le marché des métaux, monopolisé par les mines terrestres, est donc mise à l’épreuve.
C’est notamment le cas de l’entreprise canadienne « The Metal Company » (TMC). Elle a poussé, en 2021, son sponsor étatique, Nauru, à soumettre l’AIFM à une date butoir en 2023 après laquelle ses opérations d’extraction pourraient commencer avec ou sans code minier. Cette impatience défraya la chronique mais ne permit toujours pas l’aboutissement des négociations. Au contraire, tout le monde se mit d’accord pour considérer que la date butoir ne pouvait se traduire en blanc-seing pour Nauru et TMC.
Une « fausse » frustration américaine propice au trumpisme
Malgré le refus du Congrès américain de ratifier la CNUDM, l’idée de traiter les ressources de la Zone comme le patrimoine commun de l’humanité a, dès le départ, était soutenue par le président Nixon. De plus, le régime des fonds marins est généralement considéré comme faisant parti du droit international coutumier. C’est-à-dire qu’il s’appliquerait aussi au non-signataires de la CNUDM. Cela peut paraître surprenant mais c’est en réalité tout à fait commun pour des sujets aussi importants tels que la protection de l’environnement marin, l’immunité des navires de guerre ou les règles de navigation. Il serait en effet difficile de concevoir qu’un État puisse se prévaloir d’un droit de polluer les océans, sous prétexte qu’il ne serait pas partie à la CNUDM.
Ainsi, bien que l’absence d’une autorité centrale pouvant nous dire exactement ce qui relève ou non du droit coutumier laisse planer une ambiguïté relative, aucun État n’avait, jusque-là, clamé le droit de se dévaloir du régime de la CNUDM pour unilatéralement miner la Zone. Conscient de cela, l’entreprise américaine de défense Lockheed Martin a par exemple créé, en 2012, une filiale (UK Seabed Resources) au Royaume-Uni, pays signataire de la CNUDM. Le but était d’obtenir, à travers cette société affiliée, des permis de l’AIFM. L’administration océanique états-unienne (NOAA) elle-même faisait part, il y a peu, de ce constat, tout en recommandant une ratification de la CNUDM.
La dernière réunion de l’AIFM, en mars 2025, a également insisté sur ce point. C’était néanmoins sans compter sur l’avis de l’influente « Heritage Foundation », architecte du programme de Donald Trump. Cette fondation considère depuis toujours le droit des États-Unis de s’affranchir de toutes règles qu’ils n’ont pas expressément signé. Cette position satisfait particulièrement les intérêts du président américain, friand d’unilatéralisme, et frustré par la domination chinoise sur les terres rares.
Un décret sur mesure pour le secteur privé

Avec le décret du 24 Avril 2025, les États-Unis entendent donc s’affranchir d’un régime unique en son genre, basé sur la solidarité internationale, garantissant un accès à tous, et réservant une part des revenus miniers pour le bien commun.
Cela veut également dire, s’affranchir de toutes règles environnementales développées par le reste de la communauté internationale au sein de l’AIFM. Cet abandon du multilatéralisme s’accompagne au contraire d’une priorité donnée aux entreprises, en chargeant l’administration d’identifier les « intérêts privés » relatifs à l’exploitation des fonds marins et d’expédier les procédures de permis.
L’une d’entre elles est déjà toute trouvée avec TMC qui, jusque-là, était sponsorisée par Nauru et Tonga. En effet, avant même la publication du décret, TMC annonçait déjà, en mars 2025, son intention d’obtenir des permis auprès de l’administration américaine afin de miner les zones internationales réservées à Nauru et Tonga. Si ces permis sont donnés et que TMC commence ses opérations sous pavillon américain, il est peu probable que Nauru et Tonga voit un jour la couleur des revenus auxquels ils s’attendaient en sponsorisant TMC.
La France, partisane d’un moratoire, et la Chine, favorable à l’exploitation, n’ont pas tardé à critiquer cette initiative américaine. La menace d’actions unilatérales sur le Patrimoine commun de l’Humanité suffira-t-elle à pousser à un compromis qui tarde à voir le jour, ou bien fera-t-elle éclater un pan de plus du droit international ?