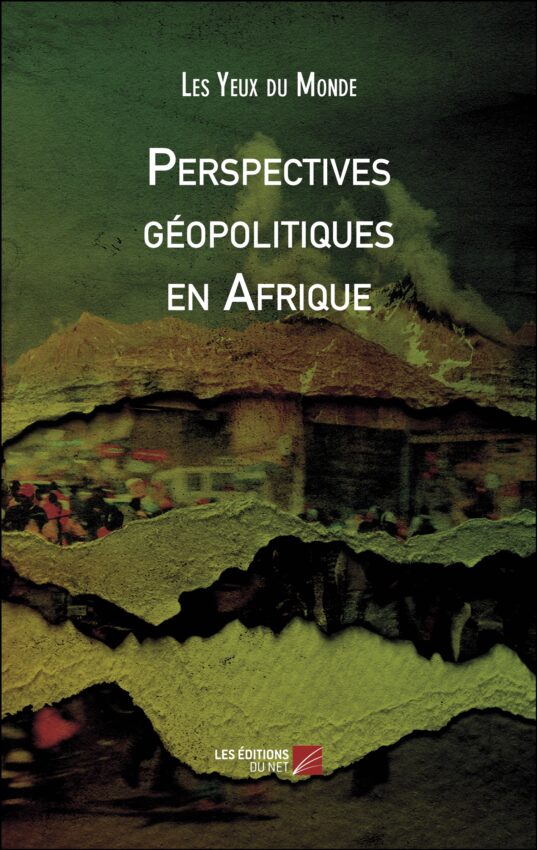Accord UE-Mercosur face à l’intégration régionale
Conclu en 2019 après plus de deux décennies de négociations complexes, l’accord d’association entre l’Union européenne (UE) et le Mercosur cristallise les tensions géoéconomiques contemporaines. Loin d’être un simple instrument de libéralisation des échanges, il incarne une recomposition des rapports de force internationaux où se confrontent ambitions stratégiques, exigences environnementales, logiques protectionnistes et intérêts industriels divergents.
Un contexte de rivalités géopolitiques et d’inquiétudes économiques
Du point de vue européen, l’accord répond à une volonté claire : celle de maintenir une influence en Amérique latine dans un contexte de désengagement américain et de montée en puissance chinoise. L’Allemagne, l’Espagne ou les Pays-Bas y voient une opportunité directe pour leurs groupes industriels, en particulier dans les secteurs de l’automobile, de la chimie ou des machines-outils. En face, le Brésil et l’Argentine espèrent écouler davantage leurs produits agricoles et relancer une croissance en berne.
Cependant, cette complémentarité apparente masque des déséquilibres structurels. Tandis que l’UE s’apprête à exporter des véhicules, des équipements et des produits pharmaceutiques à forte valeur ajoutée, le Mercosur resterait largement cantonné à ses exportations de matières premières, comme le soja, la viande bovine ou les minerais de fer. Une division internationale du travail qui interroge : en quoi un tel accord favorise-t-il un développement industriel équilibré dans les deux régions ?
Une Europe divisée entre ambitions commerciales et modèle agricole
L’un des nœuds du blocage se situe au sein même de l’UE. D’un côté, les grandes puissances industrielles du continent, l’Allemagne en tête, poussent pour une ratification rapide. Leurs groupes exportateurs, notamment dans l’automobile, lorgnent sur le marché sud-américain. De l’autre, plusieurs pays, dont la France, l’Irlande et la Pologne, s’inquiètent des conséquences sur leur agriculture. Ces derniers redoutent une mise en concurrence directe avec des produits sud-américains soumis à des normes de production bien moins contraignantes. À l’image de la viande bovine brésilienne, souvent produite à bas coût sur des terres issues de la déforestation, qui pourrait concurrencer les exploitations françaises, soumises à des exigences strictes en matière de traçabilité, de bien-être animal et d’environnement.
Le président Emmanuel Macron a d’ailleurs été explicite sur ce point. En déplacement à Buenos Aires le 18 novembre 2024, il déclarait : « La France ne soutiendra pas l’accord UE-Mercosur dans sa version actuelle ».
Ce rejet s’appuie sur une double critique : l’absence de garanties environnementales contraignantes et le risque de déséquilibres majeurs pour les filières agricoles européennes. Cette opposition n’est pas isolée. Elle reflète une tension plus large entre une Europe industrielle tournée vers les exportations, et une Europe agricole attachée à des modèles plus régulés.
L’environnement au cœur des crispations
Les débats autour de l’accord ont cristallisé l’attention sur les impacts environnementaux de la libéralisation des échanges. Le Brésil, principal moteur économique du Mercosur, fait régulièrement l’objet de critiques concernant la déforestation en Amazonie. Selon plusieurs organisations non-gouvernementales (ONG) et rapports parlementaires européens, l’augmentation des exportations agricoles, notamment de viande et de soja, encouragée par l’accord, pourrait accentuer la pression sur ces écosystèmes déjà fragilisés.
Face à ces alertes, l’accord inclut bien un chapitre sur le développement durable. Mais son caractère non contraignant est jugé insuffisant par de nombreux acteurs politiques et de la société civile. L’idée d’un « véto climatique » ou d’un mécanisme de sanctions en cas de non-respect des engagements environnementaux reste, à ce jour, une demande portée par certains États membres, sans avoir été intégrée au texte final.
Côté Mercosur, ces exigences sont souvent perçues comme du néo-protectionnisme européen. Pour les gouvernements sud-américains, les conditions environnementales imposées par l’UE s’apparenteraient à une ingérence déguisée, entravant leur souveraineté économique et leur modèle de développement.
Une ouverture commerciale à géométrie variable
Le volet commercial de l’accord prévoit la suppression progressive de droits de douane sur plus de 90 % des biens échangés. L’UE supprimera ses droits de douane sur 92 % des importations en provenance du Mercosur, tandis que ce dernier en supprimera 91 % sur les importations européennes, avec des périodes de transition pouvant aller jusqu’à 18 ans dans des secteurs sensibles. En pratique, cette ouverture bénéficiera principalement à l’UE sur les produits industriels, où elle dispose d’un avantage technologique certain. Le Mercosur, en revanche, espère tirer des gains du secteur agricole.
Toutefois, l’ampleur des effets reste limitée : les estimations prévoient une hausse du produit intérieur brut (PIB) de l’UE d’environ 0,1 % et jusqu’à 0,6 % pour les pays du Mercosur. Ces gains, relativement modestes, sont surtout concentrés sur des secteurs spécifiques, avec des effets potentiellement déséquilibrés à long terme.
Un accord suspendu entre intérêts et principes
À travers l’accord UE-Mercosur, ce ne sont pas seulement deux blocs économiques qui négocient, mais deux visions du commerce international qui s’opposent. Une vision tournée vers la compétitivité mondiale, portée par les grandes puissances industrielles européennes, et une autre plus soucieuse des équilibres sociaux, agricoles et écologiques. Son avenir dépendra de la capacité à dépasser ces clivages, à intégrer des garanties environnementales robustes, et à proposer un cadre commercial plus équitable. À défaut, il pourrait devenir le symbole d’un libre-échange dépassé, incapable de répondre aux défis contemporains de justice climatique et de souveraineté économique.
Sources:
(1) Ambec, S., Angot, J.-L., Chotteau, P., Dabène, O., Guyomard, H., Jean, S., Laurans, Y., Nouvel, Y., Ollivier, H., Coinon, M., Ferreira, A., & Kuhn-Velázquez, A. (2020). Rapport au Premier ministre : Dispositions et effets potentiels de la partie commerciale de l’Accord d’Association entre l’Union européenne et le Mercosur en matière de développement durable, 193p.
(2) Hagemeyer, J., Maurer, A., Rudloff, B., Stoll, P.-T., Woolcock, S., Costa Vieira, A., Mensah, K., & Sidło, K. (2021). Trade aspects of the EU-Mercosur Association Agreement. European Union, 208p.
(3) Mendez-Parra, M., Garnizova, E., Baeza Breinbauer, D., Lovo, S., Velut, J.-B., Narayanan, B., Bauer, M., Lamprecht, P., Shadlen, K., Arza, V., Obaya, M., Calabrese, L., Banga, K., & Balchin, N. (2020). Étude d’Impact sur la Durabilité à l’Appui des Négociations de l’Accord d’Association entre l’Union Européenne et le Mercosur. Publications Office of the European Union, 8p.
(4) Secrétariat du Mercosur. (2023). Informe Técnico de Comercio Exterior 2022, 66p