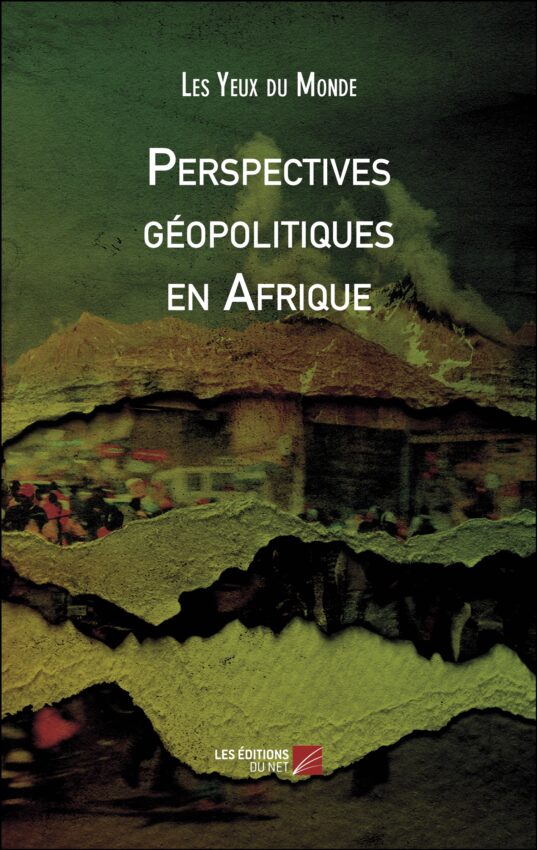L’héritage Obama en Afghanistan : de l’idéalisme d’une “guerre juste” à un minimalisme pragmatique?
Alors que Donald Trump sera investi 45e président des Etats Unis le 20 Janvier prochain, l’heure est au bilan pour l’administration Obama. Sa politique étrangère fournit à cet effet une représentation pertinente des contradictions de sa présidence. Lui qui avait été élu en 2008 en partie de par l’exaspération liée à l’interventionnisme américain post-11 Septembre, il aura été en guerre pendant ses deux mandats, établissant ainsi un précédent historique dans l’histoire politique américaine. La guerre en Afghanistan cristallise ce paradoxe : seize ans de guerre (la plus longue intervention américaine dans l’Histoire), des milliards de dollars investis, un bilan humain qui s’alourdit et des ambitions de nation-building (1) qui semblent s’effacer.

« Nous avons appris qu’il est plus difficile de finir les guerres que de les commencer, c’est ainsi qu’il en va de la guerre au XXIe siècle ». La déclaration du président américain en mai 2014 alors qu’il annonce le maintien d’environ dix mille troupes sur le sol afghan jusqu’en 2017 a fait couler beaucoup d’encre parmi les observateurs. Et pour cause, le contraste est cinglant avec l’optimisme de 2008. Le jeune sénateur de l’Illinois fait alors du désengagement américain un des axes de sa campagne d’abord pour la primaire démocrate puis pour la Maison Blanche. La dichotomie avec l’intervention en Irak est alors martelée : à l’opposé de la “dumb war” (2) irakienne, l’Afghanistan est avant tout une “good war” justifiée par le défi terroriste posé par Al Qaeda aidée par les Talibans. Dès son élection, Obama porte le nombre de militaires américains sur le terrain afghan à cent mille hommes et s’efforce de préparer la stratégie de son administration.
Au centre de la réflexion, plusieurs acteurs seront clés dans la construction d’une véritable “doctrine Obama “en Afghanistan. Outre Richard Holbrooke nommé “envoyé spécial pour l’Afghanistan et le Pakistan” en janvier 2009, Bruce Riedel, conseiller du président pendant sa campagne puis nommé à la Maison Blanche à la tête du comité de surveillance sur la politique américaine en Afghanistan, joue un rôle central. De par les écrits et déclarations distillés à la presse au cours de l’année 2009, deux évolutions semblent refléter une rupture majeure avec la doctrine Bush. Non seulement le conflit est reconfiguré spatialement à travers le néologisme de l’ »AfPak », pouvant faire espérer alors la fin d’une “politique de l’autruche” sur les interférences déstabilisatrices du Pakistan (3) mais la visée antiterroriste est établi comme la priorité, le nation-building étant ainsi relégué comme une variable instrumentale mais non secondaire.
Des reconfigurations stratégiques ayant sous-estimé la prévalence de l’influence militaire ?
Si ces éléments novateurs et l’enthousiasme du président nouvellement élu ont font penser à une réelle rupture avec l’administration Bush, plusieurs développements au cours du premier mandat vont venir contredire ce constat. La première déception arrive dès décembre 2009 et éclaire pour ainsi dire la prépondérance militaire au sein du processus décisionnel. Face à la détérioration de la situation sécuritaire, Obama se voit contraint d’envoyer 30 000 troupes supplémentaires mais ce déploiement est encadré par un calendrier strict : dès mi-2011, un retrait s’effectuera graduellement. Beaucoup pointent alors le paradoxe d’une telle décision qui reflète un président n’ayant pas voulu céder à une réponse purement militaire de par ce calendrier. Cet entre-deux s’explique avant tout par un Obama réticent à l’idée de céder à l’agenda très militaire du général Mc Chrystal soutenu par une majorité de son administration et notamment Hillary Clinton. Cet agenda illustre plus largement le déficit d’une réflexion profonde sur le terrain afghan, la préférence étant pour un raisonnement par analogie (4) voyant ainsi dans la “surge irakienne”(5) de 2007 une stratégie à succès.
Or, la stratégie de “surge” s’avère un échec et conduira au limogeage du général McChrystal en juin 2010. Son remplacement n’inaugure pourtant pas un changement de doctrine. C’est l’un des théoriciens de la contre-insurrection, commandant du CENTCOM durant l’invasion irakienne qui est nommé : le général Petraeus. La prévalence stratégique militaire s’illustre alors par le doublement des frappes aériennes, le recours toujours plus important aux attaques de drones et l’intensification de raids nocturnes des forces spéciales contre des zones insurgées. Plusieurs personnalités de premier plan affirment leurs réserves de Karl Eikenberry, ambassadeur américain en Afghanistan, à Robert Gates, secrétaire à la Défense sur l’échec avéré de la “counterinsurgency” qui est loin de “gagner les esprits et les coeurs”. (6)
De la “good war” au “Afghan good enough”
Ce que l’on pourrait qualifier de “résignation” d’un président au tout-sécuritaire ne saurait néanmoins s’expliquer par le seul pouvoir d’influence de l’état major. Les relations entre Obama et Hamid Karzai se sont constamment détériorées, entravant la réussite d’une véritable collaboration et d’un échange d’expertise dans le processus de nation building (7). Plus fondamentalement, non seulement ce même processus a manqué de renouvellement (6) mais la déstabilisation constante du pays par les avancées des Talibans soutenues en partie par le voisin pakistanais ont vu la doctrine Obama se départir de son idéalisme pour s’efforcer de contenir aussi bien l’avancée des “Talibans” que les futures potentielles critiques sur la “crédibilité américaine” à l’heure d’une sortie graduelle du conflit. Cela n’a pas pour autant empêché des revirements notables: la promesse de Mai 2014 d’évacuer tous les soldats américains d’ici 2016 a ainsi été contredite dès 2015 annonçant le maintien de 5000 troupes sur les 10000 présentes.
L’heure est maintenant aux interrogations sur la stratégie de la nouvelle administration Trump. Lui qui, comme son prédécesseur en 2008, a largement capitalisé sur le sentiment isolationniste d’une partie de l’opinion publique américaine, n’a pourtant pas hésité à nominer James Mattis, l’un des cerveaux de l’invasion irakienne, comme Secrétaire à la Défense pouvant faire craindre un ralentissement plus important du retrait des troupes américaines. Plus inquiétant, l’une des seules occurrences de la problématique afghane s’est vu évoquée à travers le prisme de la prolifération nucléaire pakistanaise semblant éclairer un manque total d’intérêt pour le défi afghan. Une ère d’incertitudes s’ouvre donc pour un conflit qui semble sans fin.
Sources:
Articles de Presse:
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/06/02/afghanistan-obama-en-echec_4931057_3232.html
http://www.courrierinternational.com/article/afghanistan-le-retour-en-force-des-talibans
http://www.nytimes.com/2017/01/01/world/asia/obama-afghanistan-war.html?_r=0
http://nation.com.pk/columns/14-Nov-2016/trump-s-world-and-world-s-trump
Articles académiques
-Dimitrova Anna, « Y a-t-il une « doctrine Obama » en matière de politique étrangère ? », L’Europe en Formation, 2/2011 (n° 360), p. 19-41. URL : http://www.cairn.info/revue-l-europe-en-formation-2011-2-page-19.htm DOI : 10.3917/eufor.360.0019
-De Coster Jamie Lynn, « Negotiating the great game : ending the U.S. intervention in Afghanistan », The Fletcher Forum of World Affairs, vol.38:2 Summer 2014
Ouvrages académiques
-Fitzgerald, David, and David Ryan. Obama, US Foreign Policy and the Dilemmas of Intervention. Houndsmill, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014. N. pag. Print. (Chapitres 1, 3 et 4)
-Jones, Seth G. In the Graveyard of Empires: America’s War in Afghanistan. New York: W.W. Norton, 2009. Print. (Chapitre 17, 18 et postface)