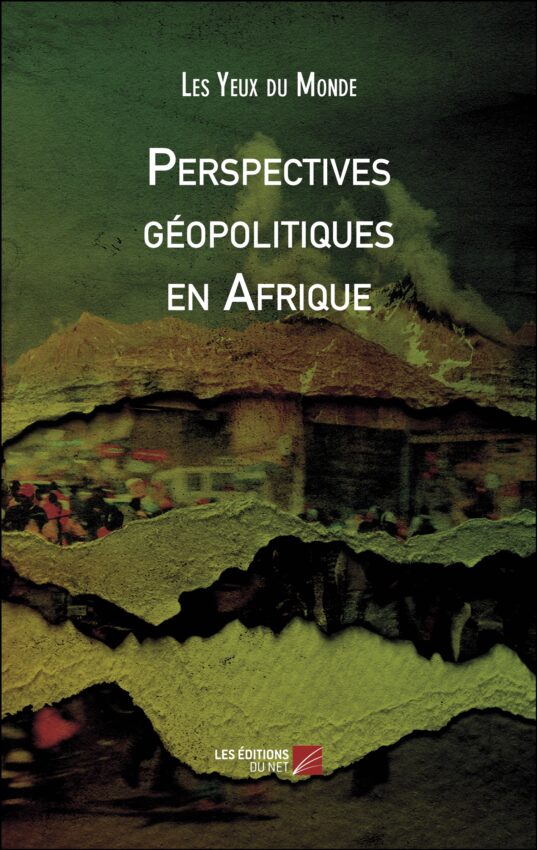Nouvelle escalade de la tension au Nagorny-Karabagh, quel avenir pour ce territoire ?
Malgré un cessez-le-feu promulgué en 1994, l’Arménie et l’Azerbaïdjan continuent de revendiquer le territoire du Haut-Karabagh, à majorité arménienne mais géographiquement fixé en Azerbaïdjan lors du dépeçage de l’URSS. Depuis le début de l’année 2017, après quelques mois de calmes relatifs, les phénomènes plus ou moins épisodiques d’affrontements se multiplient. Alors que les élections parlementaires arméniennes se tiendront le 2 avril prochain, le président arménien Serge Sarkissian a récemment averti l’Azerbaïdjan contre le lancement d’opérations militaires de grande envergure visant à déstabiliser Erevan.

Constituée de hauts plateaux fertiles, la région du Nagorny Karabagh se situe en Azerbaïdjan, au sud de la frontière avec l’Arménie. Depuis l’Antiquité, elle est convoitée pour la fertilité de ses terres noires. Lors de la soviétisation du Caucase dans les années 20, les frontières entre les deux pays furent arbitrairement définies par la Russie. A la réalité historique arménienne, selon laquelle ce territoire était, et reste, majoritairement peuplé d’Arméniens, Moscou préféra la réalité historique azérie, selon laquelle le Karabakh était déjà entre le Xème et le XIXème siècle comme un Berleyyat (duché) puis comme un Khanate (principauté) à majorité musulmane et non chrétienne.[1]
Plus tard, c’est lors de la Perestroïka que les tensions resurgissent. Les habitants du Nagorno-Karabagh font alors valoir leur droit à l’auto-détermination pour exprimer leur désaccord avec ce découpage territorial. Mais malgré les revendications, Gorbatchev ne donne aucun crédit aux velléités de rattachement à l’Arménie Soviétique. Pour Bakou, les provocations arméniennes sont intolérables, et des forces armées sont déployées. Sur le terrain, il est fait état d’exactions à Sougmaït en février 1987. En Janvier 1990, alors que les troupes soviétiques prennent d’assaut Bakou (Janvier noir), les séparatistes karabakhties font sécession et déclarent l’indépendance de la région. C’est le début d’une escalade militaire progressive et de la guerre du Nargono-Karabakh, qui durera de 1989 à 1994. A l’armée régulière azérie s’oppose alors des milices indépendantistes arméniennes soutenues financièrement et militairement par Erevan. Opérations arméniennes et opérations azéries se succèdent pendant de longs mois. En 1992, les troupes arméniennes s’emparent de la ville de Khojaly, où elles sont accusées de commettre des exactions sur des azéris, ainsi que du corridor de Lachin, qui permet de relier géographiquement l’Arménie et le Nagorno-Karabakh. En Azerbaïdjan, le président est renversé au profit de Elbulfez Elcibey pour n’avoir pas su endiguer la progression des troupes arméniennes. L’opération militaire « Goranboy » décidée par le nouveau président ne permet cependant pas aux troupes de Bakou de reprendre le dessus.
Le 5 mai 1994, après plus de vingt-mille morts et quatre résolutions onusiennes, la signature du Protocole de Bichkek par les différentes parties prenantes au conflit impose un cessez-le-feu. Cependant, les altercations à la frontière de l’été 2014, ou encore les récents combats survenus entre 2016 et 2017 viennent nous rappeler combien il apparaît urgent de trouver une solution à ce conflit gelé.
Quels axes de résolution pour le Nagorny-Karabagh ?

Malgré leur juridicité incontestable, les quatre résolutions onusiennes sur la question n’ont pas permis d’avancée majeure. Par ailleurs, il convient de rappeler que ni l’une ni l’autre des parties au conflit n’ont reconnu la Cour Internationale de Justice. Ainsi, malgré les accusations de crime de guerre émises après les pogroms de Soumgaït et de Khodjaly, il n’existe aucune possibilité condamnation pour crime de guerre, de génocide ou de nettoyage ethnique.
Ces positions reflètent donc une forme de refus de l’ingérence de la communauté internationale dans les affaires régionales de la part des belligérants, dans un espace caucasien arbitré par la Fédération de Russie. Le veto de la Russie au Conseil de Sécurité assurant par ailleurs qu’aucune Opération de Maintien de la Paix occidentale ne sera mise en œuvre aux abords de ses frontières.
C’est pour ces raisons qu’une deuxième voie de résolution fut constituée dès 1995 sous l’égide de l’OSCE. Un organe de médiation trilatéral (le groupe de Minsk), regroupant la France, les Etats-Unis et la Russie fut donc charger de créer les conditions favorables à l’émergence d’un compromis afin de lutter contre l’instabilité sécuritaire et politique régionale. Une feuille de route devant permettre une résolution politique du conflit a ainsi vu le jour en 2007. Mais les rencontres successives entre les dirigeants Arméniens et Azéris n’ont pas permis d’obtenir les résultats escomptés. De quoi faire craindre la poursuite d’un nouveau conflit armé si des avancements sur ce dossier ne se matérialisent pas rapidement.
L’interrogation sur les rôles russe et turc
Dans le processus de résolution de ce conflit, c’est avant tout l’axe russo-turque qui s’avèrera déterminant. La Turquie entretient en effet des liens très étroits avec l’Azerbaïdjan, tous deux turcophones. Quant à Moscou, malgré son rôle de garant du dialogue arméno-azéri, elle cultive une certaine ambiguïté dans ses relations au deux belligérants. Ainsi, elle fournit les deux armées en matériel. Elle dispose même d’une base militaire en Arménie, à Gyumri, au nord d’Erevan. Pas moins de 5000 soldats y stationnent. En 2016, un accord militaire reconductible de quatre ans a été signé entre la Russie et l’Arménie. Ce dernier prévoit qu’en cas d’attaque, les troupes russes interviendront pour garantir l’intégrité territoriale du petit pays caucasien. Cependant, cet accord exclue de son champ d’application les affrontements armés qui surviendraient au Haut-Karabagh, afin de ne pas envenimer les relations entre Moscou et Bakou.
Face à ce statuquo, des concessions turques quant à la reconnaissance officielle du génocide arménien permettrait certainement de faire avancer le dossier karabaghtie. En effet, « le génocide reste le socle national des Arméniens ; il les lie et les unit pour le meilleur et pour le pire, tout en demeurant l’enjeu premier du débat politique. Le meilleur est la volonté d’être ensemble, le pire la malédiction qui pèse à travers le souvenir entretenu comme une douleur inextinguible. »[2] Dans la jeune génération, beaucoup rêvent de s’affranchir de ce lourd passé pour pouvoir, enfin, tourner la page. A travers ce prisme, la guerre avec l’Azerbaïdjan, au-delà de la conquête de provinces adjacentes au Nagorny-Karabagh, s’apparente alors à la volonté de reconquérir une dignité nationale. Comme si, dans l’imaginaire collectif, des siècles après la fin de la domination ottomane, les Arméniens se sentaient encore marqués du sceau de « dhimmis »[3]. Dans ce contexte, et malgré un développement économique relativement modeste, le Karabagh a la saveur d’une victoire militaire. Elle nourrit la légitimité des gouvernements arméniens au pouvoir, lesquels en ont bien besoin au regard du mécontentement grandissant de la population à l’égard de la corruption des élites politiques.
Dans ce contexte, les clés de résolution que sont les territoires occupés (et non le Nagorno-Karabakh) ainsi que le Nakhitchevan n’ont que trop rarement été évoqués. Car avant l’engagement de réels pourparlers, le mise en place de meilleurs mécanismes d’enquête sur les incidents et une surveillance sans faille du cessez-le-feu sous les auspices de l’OSCE s’avère primordiale.
______________________________________________________________________________________________________
[1] Claudia LOSTANLEN, Etudes Géostratégiques, « Le conflit gelé du Nagorno-Karabakh : L’incompatibilité des principes d’intégrité territoriale et d’auto-détermination », 13 septembre 2015
[2] Antoine MAURICE, Esprit, « Carnet de route en Arménie : lieux et fardeaux de la mémoire », juillet 2013
[3] Le terme de dhimmis renvoie aux chrétiens et les juifs qui vivaient en tant que minorités dans les Etats musulmans. Leur présence était codifiée par la loi, leur attribuant droits et devoirs. Les dhimmis ne possédaient cependant pas le statut de citoyens à part entière. En échange du paiement d’un impôt, et du renoncement à prétendre être les égaux en droit des musulman, les dhimmis furent acceptés et, dans certains cas, vivre en harmonie avec le reste de la population locale.