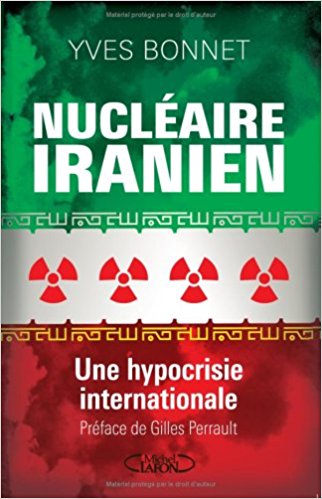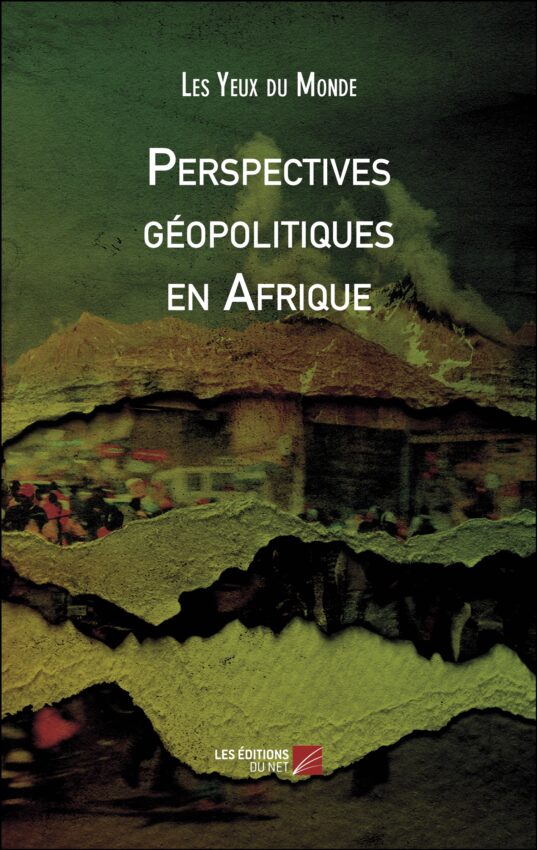Une histoire de la guerre contre le terrorisme au XXIe siècle.
Marc Hecker et Élie Tenenbaum sont deux chercheurs spécialistes des questions stratégiques. Ils sont rattachés au Centre des études de sécurité de l’Institut français des relations internationales (Ifri). Leur ouvrage « La Guerre de vingt ans » a été publié en avril 2021 aux éditions Robert Laffont, et récompensé par le Prix du livre de géopolitique 2021.
Amorcée au mois de mai 2021, le retrait des troupes américaines en Afghanistan symbolise la fin d’une séquence ouverte il y a maintenant vingt ans. Deux décennies après l’onde de choc du 11 septembre 2001, la nécessité de dresser un premier bilan de la « guerre contre le terrorisme » s’impose.

La Guerre de vingt ans. Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle y contribue de façon inédite avec l’intention d’en retenir des enseignements pour l’avenir. Cette rétrospective pose les premiers jalons d’une histoire connectée des guerres menées depuis vingt ans par les occidentaux, les américains en tête, face à un ennemi conceptuel : le terrorisme. Aux auteurs de rappeler que, « depuis longtemps déjà, policiers, militaires et stratèges ont mis en évidence la futilité de déclarer la guerre à un mode d’action » (p. 377). En d’autres termes, être en mesure de caractériser correctement la menace détermine la façon d’y répondre. En ce sens, la réflexion des auteurs porte sur la dialectique qui s’installe entre la pensée stratégique des djihadistes et les efforts entrepris depuis 2001 pour lutter contre la menace terroriste. Ainsi, « Djihadisme » et « contre-terrorisme » polarisent, sous l’impulsion des États-Unis, le cycle stratégique international qui s’installe à la suite des attentats du World Trade Center.
Le djihadisme est défini comme « une doctrine politique et religieuse qui prône la lutte armée au nom d’une conception fondamentaliste et violente de l’islam » (p. 10). La particularité de cette idéologie, qui utilise la violence terroriste comme mode d’action, est de prétendre apporter une réponse aux problématiques politiques et sociales des sociétés musulmanes en prônant le retour à l’islam des origines. Du côté de la réaction face à cette menace, le camp du « contre-terrorisme » rassemble les États coalisés sous la bannière de l’OTAN et des États-Unis. À travers le croisement de deux disciplines, la « djihadologie » et les études sur le contre-terrorisme, naît l’ambition d’adopter un véritable point de vue stratégique qui « suppose de s’intéresser aux différentes parties d’un conflit » (p. 12) pour comprendre son déroulement.
À la recherche des causes du prolongement de cette guerre, les deux auteurs portent le diagnostic, en cinq actes, de la fin d’un cycle stratégique après vingt années d’opérations extérieures. Du début des guerres contre « l’hyper-terrorisme » du 11 septembre (2001-2006), à l’ère de la contre-insurrection et la mort de Ben Laden (2006-2011), les grandes puissances coalisées se sont mises en ordre de bataille face à la mouvance d’al-Qaïda. La seconde décennie, marquée par la crise bancaire des Subprimes en 2007, s’ouvre dans une dynamique de réduction des effectifs au Moyen-Orient. Mais la vague des printemps arabes relance la machine interventionniste en Syrie et en Libye (2011-2014). La secousse politique au Moyen-Orient, avec la chute de Saddam Hussein en 2006 et le déclenchement de la guerre civile syrienne, favorise l’apparition d’un nouvel ennemi qui émerge progressivement sous le nom d’État islamique en Irak et au Levant (2014-2017). Enfin, la chute du Califat en 2019 ne signe pas pour autant la fin du djihadisme, dont le centre de gravité semble s’être déplacé vers l’Afrique. La lutte contre le terrorisme va donc se poursuivre, mais dans un contexte géostratégique international reconfiguré (2018-2021).
Cet ouvrage propose de conclure chacun de ces actes par des enseignements stratégiques dont il est difficile de rendre compte de manière exhaustive et concise. Deux grandes perspectives sont néanmoins observées dans ce livre. D’une part, il envisage l’avenir du djihadisme qui constitue toujours une menace aujourd’hui (I). D’autre part, il interroge les possibilités d’évolution du contre-terrorisme sur le plan stratégique à l’échelle mondiale (II).
I) La persistance du terrorisme djihadiste
Le danger de laisser un sanctuaire djihadiste se développer localement, en raison de la dimension également globale du djihad, constitue un des principaux enseignements de cette guerre de vingt ans. La persistance des filiales de Daech et des groupes d’obédience qaïdiste, en particulier en Afrique, montre que l’épicentre du djihadisme international s’est déplacé et qu’il représente toujours une menace pour les États.
Une menace hybride
Premièrement, les auteurs s’attachent au concept d’hybridité dans leur définition de la menace djihadiste. Dans le souci de bien « nommer l’ennemi » en stratégie, ils présentent les deux grandes théories du djihadisme des années 2000. La première prône la sanctuarisation par l’installation d’un Califat central, administrant un territoire et disposant d’une armée de combattants à l’image d’un État[1] (ou plutôt d’un proto-État) ; la seconde, développée en réaction à la débâcle d’al-Qaïda face à l’armée américaine à Tora Bora, mise sur la décentralisation de l’affrontement[2] via « l’adoubement de filiales » (p. 378) et la propagande en ligne. Les deux légitiment une même méthode : le terrorisme. En pratique, devant l’échec d’al-Qaïda en Afghanistan, l’organisation s’est alors mutée en structure décentralisée, fonctionnant par réseaux pour reconstituer ses forces et étendre ses capacités de nuisance dans le monde entier. Par conséquent, face aux efforts du contre-terrorisme, la richesse du répertoire stratégique djihadiste semble être à la source de la résilience des individus qui s’en réclament, qu’ils soient partisans de la sanctuarisation ou de la décentralisation.
De ces deux conceptions découle la notion d’un djihad « glocal » (p. 363) utilisée par les auteurs. Ils expliquent tout d’abord la rhétorique d’une lutte idéologique globale du djihad connectant les différents théâtres de conflits moyen-orientaux et africains. Ce phénomène d’internationalisation s’est particulièrement accentué pendant les printemps arabes de 2011. Apparaissant comme un vent d’espoir démocratique, ces révoltes populaires ont dans le même temps offert aux entrepreneurs djihadistes l’opportunité de légitimer leur projet d’alternative politique : le retour aux sociétés islamiques des origines. De nombreux combattants étrangers, séduits par la propagande d’un « djihadisme 2.0 », ont ainsi gagné la zone syro-irakienne entre 2012 et 2017 pour rejoindre Daech[3]. Les auteurs insistent ensuite sur le caractère également local de la menace. S’il s’agit bien d’une idéologie de portée globale, ses racines demeurent profondément locales. En effet, elle vise à légitimer un projet politique auprès des populations, en se greffant sur des conflits préexistants, et dans des zones souvent mal contrôlées par les États. L’Afrique apparaît dans ce cadre comme une terre d’avenir pour le djihadisme.
L’Afrique, nouvel épicentre du djihadisme mondial
À l’issu des printemps arabes, le continent africain est progressivement passé au premier rang des zones concernées par le terrorisme. En mars 2011, l’intervention militaire de l’OTAN en Libye, provoquant la chute du régime de Kadhafi, est aujourd’hui largement pointée du doigt comme le péché originel de la déstabilisation du Sahel[4]. Mais l’avis des deux experts est plus nuancé : « En matière de stratégie, l’indécision se paie parfois aussi cher que les mauvaises décisions » (p. 242). En effet, les conséquences et les coûts de l’intervention, comme de la non-intervention, ne peuvent être connus à l’avance. Ainsi, face à la conception simpliste d’une gestion nationale du risque terroriste, les auteurs tranchent sur un point : la lutte contre cette menace, parce qu’elle est hybride, ne peut seulement se résumer à une réponse judiciaire et policière sur le territoire national. Le développement de sanctuaires à l’étranger impose en parallèle d’intervenir militairement à l’extérieur des frontières. En juin 2021, le choix du président français annonçant la fin de Barkhane en tant qu’opération extérieure ne signe pas la fin de la coopération sécuritaire régionale. Elle traduit au contraire un besoin d’adaptation stratégique face à une menace terroriste évolutive et qui s’étend désormais au Golfe de Guinée.
Ensuite, l’ouvrage revient sur l’apparition des différents groupes armés terroristes (GAT) au Sahel, au Nigéria, en Somalie et en Mozambique, en mettant en valeur leurs dynamiques locales, entre jeux d’alliance et divisions internes. La question de leur financement est notamment abordée. Les auteurs soulignent l’importance des revenus tirés de l’imposition forcée des populations dans les zones qu’ils contrôlent (la zakat), à côté des bénéfices liés aux trafics illicites transsahariens[5]. Dans ces régions, la faiblesse des États, les tensions inter-ethniques et l’instabilité politique forment un terreau favorable aux rébellions dont se servent les djihadistes pour affaiblir les États. L’avenir du djihadisme, et à travers lui la violence terroriste, semble effectivement s’orienter en Afrique. En résumé, les États font face à une menace hybride à l’emprunte aussi bien locale que globale, diffuse ou bien sanctuarisée sur le plan tactique selon les régions[6], et profitant du déficit de gouvernance pour prospérer. Cependant, si le terrorisme reste un enjeu majeur de la sécurité internationale aujourd’hui, il n’en est plus l’axe structurant. Nous assistons ainsi à la fin d’un cycle stratégique.
II) La fin du cycle stratégique de la « guerre » contre le terrorisme
L’importance de ne pas sous-estimer la menace, sans pour autant sur-réagir à celle-ci au risque de s’enferrer dans une logique contre-productive, s’est progressivement imposée aux praticiens du contre-terrorisme. Partant de ce deuxième enseignement fondamental, le postulat qu’adoptent les auteurs nous révèle qu’un cycle stratégique ouvert en 2001 est sur le point de se refermer, au moment où s’en ouvre un autre dans lequel la lutte contre le terrorisme n’est plus la clé de voute de la politique sécuritaire des États.
Une nouvelle vision stratégique du contre-terrorisme
Le déclenchement de la « global war on terror » en Afghanistan caractérise le passage d’une logique de lutte à une logique de guerre contre le terrorisme. Le terme de « guerre » reflète en effet la posture belliqueuse adoptée par l’administration Bush en réponse aux attentats face aux pays « sponsors » du terrorisme, et perçue par les auteurs comme la réaction de l’hyperpuissance du moment au défi de « l’hyper-terrorisme ». Mais l’intervention en Irak à partir de 2003 vient fissurer le consensus international autour de la guerre contre le terrorisme acquis après l’émotion du 11 septembre. Cet épisode, qui figure aujourd’hui comme un cas d’école des excès de l’interventionnisme américain, illustre parfaitement le problème d’une politique de changement de régime (la « débaasification » du régime irakien), menée par une puissance étrangère sans stratégie de reconstruction et de stabilisation post-conflit. Principale leçon : le vide sécuritaire et politique doit être comblé par l’installation d’un État légitime, au risque, dans le cas contraire, d’alimenter la contestation sur laquelle prospèrent les entrepreneurs djihadistes. Cette séquence est ensuite marquée par la redécouverte des principes de la contre-insurrection des années 1960[7], se traduisant par la hausse considérable des dépenses du Defense Department[8].
Si l’expérience américaine en Irak devient le symbole d’un interventionnisme excessif et contre-productif, les deux spécialistes soulignent une évolution de la vision stratégique, portée par les démocrates américains, au profit d’une approche plus légère et moins coûteuse sur le plan politique et financier. En 2009, la « doctrine Biden », alors Vice-président sous Obama, prône le recours au triptyque opérationnel « renseignement, drones, forces spéciales » dans une dynamique de retrait des troupes sur le terrain. Délaissant l’objectif de la pacification complète jugé trop ambitieux (objectif de la contre-insurrection), il s’agit avant tout de concentrer les efforts militaires sur l’affaiblissement de l’ennemi, jusqu’à ce que le gouvernement local puisse assurer seul la sécurité sur son territoire. Cette vision stratégique, aujourd’hui largement institutionnalisée notamment en France, entérine les pratiques d’une forme de contre-terrorisme amenée à perdurer à l’heure de la compétition des puissances.
Le contre-terrorisme à l’ère de la compétition des puissances
Dans cette perspective, le véritable intérêt de cette contribution est d’inscrire la réflexion sur l’avenir du contre-terrorisme dans le nouveau contexte géostratégique mondial. Bien plus qu’une histoire de la guerre contre le terrorisme, ce travail de prospective et de réflexion géostratégique se distingue par la pertinence de sa démarche didactique, précieuse pour comprendre les enjeux et relever les défis de demain. En effet, les auteurs constatent que l’engouement stratégique pour la « guerre contre le terrorisme » au bilan peu concluant, s’essouffle à l’aune du nouveau défi géopolitique pour les occidentaux : la montée en puissance de la Chine. À ce titre, la crise du coronavirus est clairement apparue comme le catalyseur de la rivalité sino-américaine. Le contre-terrorisme, principale boussole de la politique sécuritaire occidentale depuis 2001, cède donc le pas à la compétition des puissances notamment dans le domaine militaire où l’attention se porte désormais vers la « haute intensité ».
Peu abordé dans le livre, le concept de haute intensité renvoie à des formes de conflits plus conventionnels où tous les milieux de conflictualité sont susceptibles d’être contestés par les belligérants (Air, Mer, Terre, espace extra-atmosphérique, cyberespace, champ informationnel). À l’inverse, dans le cas des conflits asymétriques, l’ennemi ne dispose pas des mêmes moyens technologiques, le conduisant à recourir à des modes d’action détournés ou « non-conventionnels », comme le terrorisme. Comme le relevait le général d’armée Thierry Burkhard en octobre dernier : « On ne peut pas se préparer à quitter l’asymétrie. Des adversaires chercheront encore à nous combattre de manière asymétrique. Mais aujourd’hui, […] il faut envisager un retour à des conflits de haute intensité – c’est une question de volume, d’unités mobilisées, mais aussi de menaces auxquelles nous sommes confrontées[9] ». En 2020, cette compétition à l’échelle mondiale s’est traduite par une hausse généralisée des dépenses militaires (+ 2,6 % par rapport à 2019[10]), qui correspond à la volonté de réadapter les armées en prévision d’un affrontement interétatique, sans toutefois tourner la page de la guerre asymétrique.
Conclusion
« Si l’on devait ne retenir qu’une seule leçon de la guerre de vingt ans, c’est qu’il faut autant se méfier de nos surréactions et ambitions démesurées, que des sous-estimations de la menace et de notre pusillanimité. L’hubris est mauvaise conseillère et le terrorisme – qu’il soit djihadiste ou non – se nourrit de la rage et des erreurs de son adversaire : comme au judo, il utilise son poids pour le faire basculer. Face à la violence et la haine, il s’agit donc de garder la tête froide » (p. 386). Comme le préconisent les auteurs, discernement et mesure doivent rester les maîtres-mots, sans quoi la lutte contre le terrorisme ressemblerait à un interminable travail de Sisyphe.
Dans cette optique, le cas de la France fait l’objet d’une attention particulière dans la réflexion des deux experts sur l’avenir de l’antiterrorisme, dépassant le seul registre sécuritaire : « Une chose est sûre, dans une France en voie d’« archipellisation », l’attention des autorités publiques s’est déplacée du champ sécuritaire au sociétal : l’objectif n’est plus uniquement de lutter contre le terrorisme mais de maintenir la cohésion de la nation » (p. 386). Les courants extrémistes, qu’ils soient islamistes ou identitaires, attisent la polarisation de la société. Faisant écho à la loi contre le séparatisme adopté le 23 juillet 2021, les auteurs perçoivent ce phénomène comme une brèche exploitable par les terroristes, qui cherchent justement à installer le chaos là où ils le peuvent.
Ainsi, dans un monde qui compte deux à trois fois plus de combattants djihadistes qu’il y a vingt ans[11], les nouvelles priorités géostratégiques sont loin d’écarter la nécessité de lutter contre le terrorisme. En Afghanistan, en Irak, tout comme au Mali, les pays occidentaux ne sont pas parvenus à trouver des partenaires politiques locaux à la hauteur des enjeux sécuritaires, et dont dépendent les résultats de la coopération militaire. Le reflux de l’antiterrorisme que symbolise le retrait total des troupes américaines d’Afghanistan, prévu pour la fin du mois d’août, ne doit pas nourrir d’illusions. Ce n’est pas parce que l’on décrète unilatéralement la fin d’une guerre qu’il en est de même sur le terrain. De cet ultime enseignement, une page semble en effet s’être tournée dans la lutte contre le terrorisme. Mais son histoire, elle, continue.
Paris, 4 août 2021.
[1] Abou Bakr Naji, The Management of Savagery. The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass, 2006.
[2] Abou Moussab al-Souri, “The military theory of the global Islamic resistance call”, traduit et reproduit in Brynjar Lia, Architect of Global Jihad : The Life of Al-Qaida Strategist Abu Mus’ab Al Suri, New York, Columbias University Press, 2008, p. 359.
[3] De 2012 à 2017, on estime à plus de 40 000 le nombre d’étrangers venus du monde entier faire le djihad en zone syro-irakienne, démontrant la puissance mobilisatrice du djihadisme en ligne. Les maghrébins en tête (19 000), suivis par les européens du Caucase (7 000) et par les occidentaux (6 000).
[4] Dans la crainte d’un massacre de masse, l’opération Unified Protector (OTAN), lancée le 19 mars 2011, a stoppé l’avancée des troupes de Mouammar Kadhafi vers le camp des rebelles retranchés à Benghazi. Elle prend fin le 31 octobre 2011, soit onze jours après la mort du colonel. De nombreux mercenaires Touaregs anciennement au service du régime se retrouvent sans emploi et reviennent au Mali nourrir les rangs des rebelles du nord, apportant avec eux armes et véhicules de guerre.
[5] Voir Judith Scheele, « Circulations marchandes au Sahara : entre licite et illicite », Herodote, n° 142, La Découverte, 2011, p. 143-162 et Tigrane Yégavian, « L’Afrique de l’Ouest, ventre mou du narcoterrorisme », Conflits, n° 34, bimestriel, Antéios, juillet-août 2021, p. 53-56.
[6] Par exemple, al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) s’organise grâce à une stratégie d’affrontement décentralisé au Mali, lorsque la mouvance d’al-Shebab s’est constitué un sanctuaire en Somalie.
[7] Voir David Galula, Counterinsurgency Warfare : Theory and Practice, New York, Preager Security, 1964. Traduit en français par l’officier de liaison Philippe de Montenon et publié sous le titre Contre-insurrection. Théorie et pratique, Paris, Economica, 2008.
[8] Entre 2001 et 2009, les dépenses annuelles du département de la défense passent de 9 millions à 580 millions de dollars annuels en matière de guerre de l’information (p. 54).